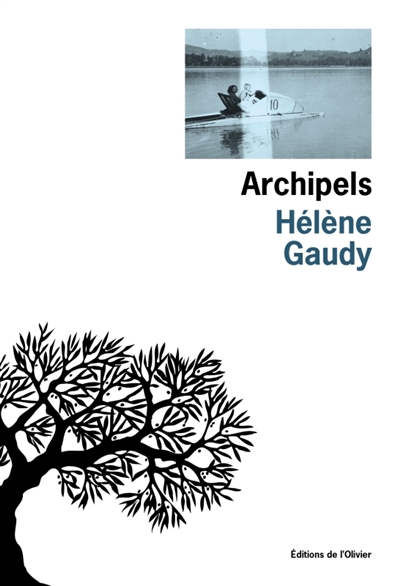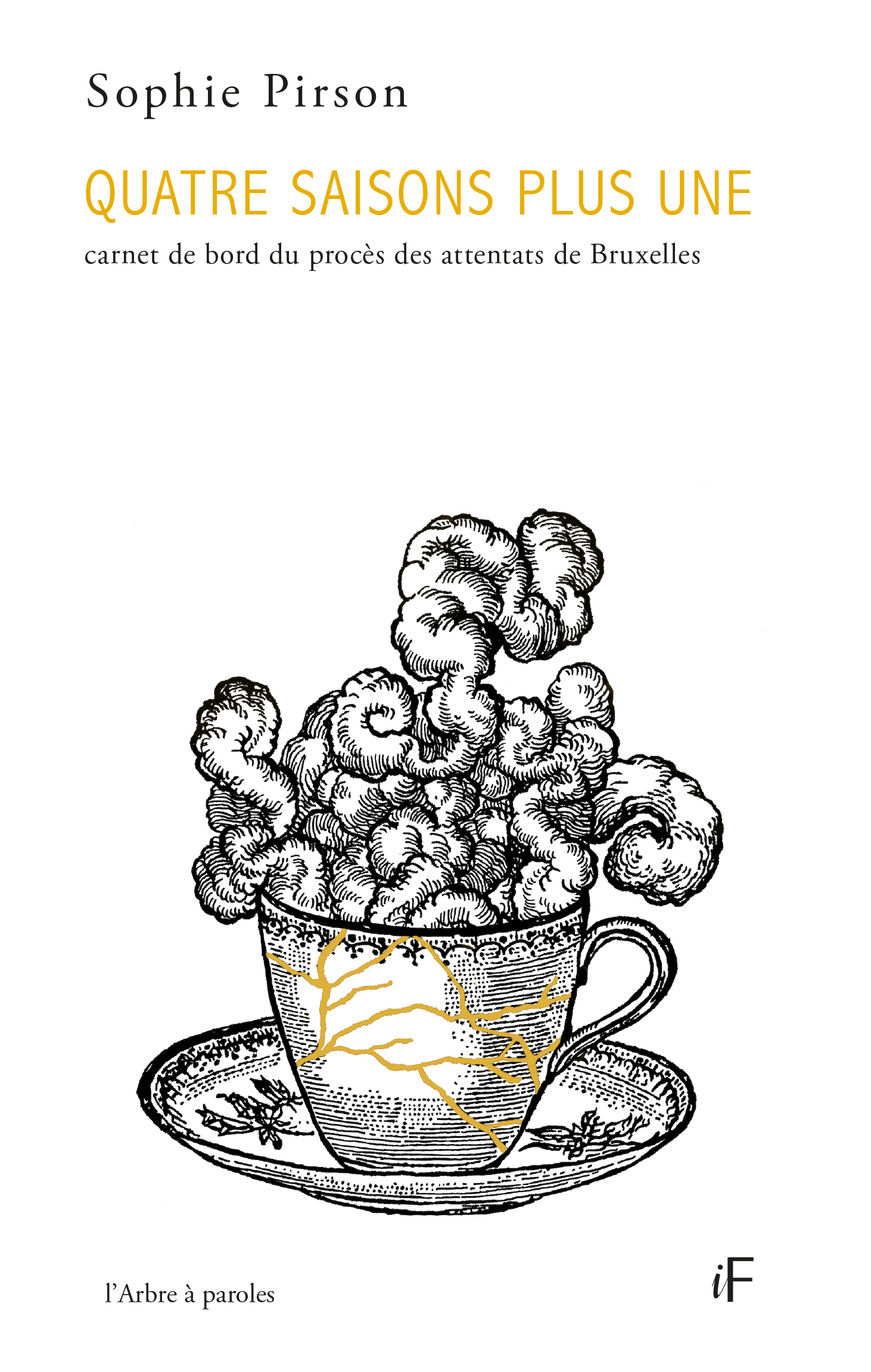Littérature française
Hélène Gaudy est la romancière des paysages mouvants. Elle en capte comme personne les lumières changeantes, les métamorphoses et le trouble qu’elles éveillent. Chacun de ses livres pourrait porter le titre du dernier, Archipels : un mot qui invite au dialogue, au mouvement, au multiple. S’il s’inscrit en archipel avec ses précédents romans, ce nouveau livre ouvre aussi de nouveaux horizons, fragiles, intimes, passionnants.
"Il y aurait là-bas, à l’autre bout du monde, une île". Archipels naît de ces mots de Georges Perec, et aussi du hasard d’une flânerie sur le net qui fait découvrir à Hélène Gaudy l’existence de l’Isle de Jean-Charles. Petit morceau de terre des confins de la Louisiane, l’île est en train de disparaître, submergée par la montée des eaux. Bientôt il n’en restera rien, et rien non plus de la communauté qui y vivait, derniers Amérindiens francophones dont les légendes, les racines, les gestes seront mêmement engloutis. Le père d’Hélène Gaudy s’appelle Jean-Charles lui aussi. En s’intéressant à l’île, la fille sait qu’elle part en quête de son père, cet homme qui dit ne pas avoir de souvenir d’enfance et dont elle est si proche tout en le connaissant si peu.
Une vie, comme un paysage: mouvante, étonnante, impossible à embrasser d’un seul regard.
Une vie, comme un paysage: on apprend patiemment à en déchiffrer les strates, les lignes de fuite, la mémoire.
Comme pour marquer son accord au projet qu’a sa fille d’approcher son histoire, le père d’Hélène Gaudy lui donne les clés de son atelier. Artiste plasticien, il y a accumulé une vie durant des livres, des objets, des outils, des œuvres d’art... Pour lui, ces trouvailles amassées étaient comme les brouillons d’œuvres à venir. Pour sa fille, l’accumulation serait plutôt une manière de se constituer une mémoire, "celle de tout le monde et de personne, la moins sélective possible, une vie patiemment noyée dans celle de ses semblables [...]. Faire soi ce rapiècement, ces mille fragments des autres, faire peau cette carapace dans laquelle disparaître".
Comme une archéologue, Hélène Gaudy exhume dans l’atelier, dans les carnets et les archives de son père les bribes de ce qu’est une vie, sa vie. Elle les passe au tamis, les ramène à la lumière, les fait dialoguer. Apparaît peu à peu le portrait du petit garçon que fut Jean-Charles, grandi dans une France en guerre. Ses parents résistants lui avaient appris à répondre, si on l’interrogeait sur son lieu de résidence: À Muzainville. Un nom qui ne figure sur aucune carte: "Enfant, mon père habitait un lieu qui n’existe pas". De cette enfance cachée, de l’adolescence vagabonde qui la suit puis des années algériennes de son père, Hélène Gaudy tire un fil après l’autre, effleure les vérités, renonce à tout comprendre: "on n’attrape pas les pères comme des papillons".
Puis il y a la rencontre avec sa mère, un amour au long cours dans la lumière duquel Hélène Gaudy a grandi et qui irrigue son livre. Des lettres qu’ils se sont échangés, elle ne lit que le début, l’étincelle, renonçant "à tenir entre mes mains l’intimité de mes parents". Autant qu’un livre sur la figure de son père, Archipels est un livre sur le couple de ses parents, heureux, attentif, en équilibre. "Les parents sont des mégalithes dans notre champ de vision. On passe sa jeunesse à tenter de voir le paysage qu’ils nous cachent, et puis, un jour, ils sont devenus de toutes petites pierres, des cailloux. Là seulement on peut les prendre dans la main, toucher leur texture et leurs failles. Regretter de ne pas l’avoir fait plus tôt, quand ils étaient immenses, quand tout était encore devant eux".
Avec pudeur et une immense douceur, Hélène Gaudy questionne le passé pour éclairer le présent et renouer les fils de la transmission. Son écriture aérienne et légère nimbe le livre d’un voile de tendresse – mots d’amour et d’affection pour ce père-archipel, devenu insubmersible grâce au livre de sa fille.
Éditions de l'Olivier, 21 euros
Disponible en format numérique ici
Le 22 mars 2016, jour funeste des attentats de Bruxelles, la seconde fille de Sophie Pirson est grièvement blessée dans le métro de Maelbeek. Sidération.
Depuis ce séisme qui a ébranlé la vie de sa fille et de leur famille, Sophie Pirson a décidé de rejoindre un groupe de paroles créé à Bruxelles, où se retrouvent des survivants et des proches ainsi que des parents de jeunes gens radicalisés.
De cette expérience naîtra un livre, Couvrez-les bien, il fait froid dehors, dans lequel Sophie Pirson mêle sa voix à celle de Fatima Ezzarhouni, mère d’un jeune homme aujourd’hui décédé en Syrie. Toutes deux jeunes grand-mères, elles décident de réfléchir à la transmission. Que souhaitent-elles transmettre à leurs petits-enfants de notre monde déchiré?
Sophie Pirson entame alors un travail d’écriture pour dire au plus près leur amitié, leurs échanges, leurs doutes. La terreur qui les habite, autant que la joie qui peut surgir d’un échange, d’un repas partagé.
Ce livre émouvant et lumineux sera suivi de très nombreuses interventions des deux amies dans des écoles, des institutions ou d’autres groupes de paroles. Sophie Pirson se confronte alors à un questionnement philosophique incessant: qu’y a-t-il entre la haine (qu’elle ne ressent jamais) et le pardon (qui lui semble très éloigné)? Que mettre dans cet espace caché dans les plis de la langue?
Quelques mois plus tard s’ouvre le procès historique des attentats. Sophie Pirson décide de s’y rendre chaque jeudi, avec l’idée d’approcher une forme de réponse à son questionnement, prendre à bras le corps le sujet du pardon à travers ce projet d’écriture. Car c’est un carnet et un crayon à la main que Sophie Pirson franchit les portes de "Justitia", ce méga-palais de Justice, dont le nom sonne comme [celui] d’une île gagnée par des pirates.
Débute alors un passionnant journal de bord, à la fois très intime et qui invite au recul, à la réflexion. Sophie Pirson observe les moindres détails des rouages de cette grande machine judiciaire, incarnée par les magistrats, les jurés, les accusés, la police, les avocats et journalistes.
 Elle noue des liens forts avec celles et ceux qui, pendant des mois, assistent à ce procès hors-normes. Des survivantes et survivants, des proches, des plus lointains, des observateurs. Des femmes et des hommes qui, de mois en mois, devront faire la rude expérience de cette traversée au long cours, faite de doutes, de colères, de jours sombres et d’espoir. Dans les couloirs, le réfectoire, tous les "à-côtés", elle traque sans relâche les regards, les larmes, les mains noueuses. Elle accueille la parole sur le vif, celle qui surgit au sortir d’une journée d’audience, celle qui se fraye un chemin au milieu de toutes les émotions contradictoires.
Elle noue des liens forts avec celles et ceux qui, pendant des mois, assistent à ce procès hors-normes. Des survivantes et survivants, des proches, des plus lointains, des observateurs. Des femmes et des hommes qui, de mois en mois, devront faire la rude expérience de cette traversée au long cours, faite de doutes, de colères, de jours sombres et d’espoir. Dans les couloirs, le réfectoire, tous les "à-côtés", elle traque sans relâche les regards, les larmes, les mains noueuses. Elle accueille la parole sur le vif, celle qui surgit au sortir d’une journée d’audience, celle qui se fraye un chemin au milieu de toutes les émotions contradictoires.
Jour après jours, mois après mois, il me faudra être attentive aux bruissements de paroles urgentes, aux mots échangés à bas bruit, mais aussi tendre l’oreille au silence pour écouter ce qui ne se dit pas.
Sophie Pirson trouve une place dans ce grand tout et va entrevoir, ici et là, des éléments qui viendront se glisser dans cet espace entre la haine et le pardon. Son écriture du réel nous embarque à ses côtés, de ses périples en bus pour rejoindre cette "île" à la chaise qu’elle occupe dans un couloir ou la salle d’audience. Elle partage avec nous le chemin sinueux de celles et ceux qui doivent continuer à vivre après leur traversée des ténèbres.
Le roman est bref mais il déploie toute une constellation d'histoires, ces "contes" enchâssés, ces "on raconte encore que" qui sont l'âme et la pulsation de Nord Sentinelle. Tant d'histoires dont les motifs s'éclairent et se répondent, pour composer avec une virtuosité peu commune un livre qui est, à n'en pas douter, l'une des lectures les plus marquantes de cette rentrée littéraire.
Avec ce roman qui se présente comme le premier d'un nouveau cycle, Jérôme Ferrari poursuit une œuvre passionnante, qui parle de mondes défaits, de mal, de violence et de la quête entêtée de rédemption. Une œuvre qui questionne aussi le rapport à l'autre, dans l'infini nuancier de ses manifestations, et qui se dépose dans une langue dense, épurée, à la beauté sombre.
À la suite de tant de grands livres – Où j'ai laissé mon âme, Le sermon sur la chute de Rome (Prix Goncourt 2012), Le principe, Á son image –, Nord Sentinelle s'enracine entre réel et fiction. Il puise son point de départ dans un fait divers bête et sordide, l'assassinat d'un jeune touriste par un restaurateur corse mis hors de lui lorsqu'il se rend compte qu'une bouteille d'alcool a été introduite illégalement dans son établissement. Cette histoire sinistre devient le déclencheur des réflexions du narrateur, cousin de l'assassin, consterné tant par l'étroitesse d'esprit de ses compatriotes que par l'arrogance et la suffisance des touristes. Les dérives du tourisme de masse sont dépliés avec beaucoup d'humour et une ironie pétillante. Le narrateur est à l'affût des turpitudes de chacun – la cupidité des Corses, la niaiserie des touristes enquête d'une fausse authenticité, la laideur d'un monde standardisé et kitsch. "Nous avons ouvert grand nos bras d'imbéciles au premier voyageur et d'autres voyageurs l'ont suivi et nous nous sommes retrouvés pris au piège de l'épouvantable dialectique qui nous oppose et nous lie indéfectiblement à eux dans un face à face de corruption mutuelle où chacun révèle les vices de l'autre en lui exhibant les siens, des vices de plus en plus répugnants, car je sais bien que nous ne sommes pas innocents, nous consentons à la transformation du monde en gigantesque centre commercial". Entre dégoût et désespoir, le narrateur a l'acuité mordante et nous régale de quelques scènes d'une grande drôlerie, comme la description d'un team building ponctué de chants polyphoniques corses ou le récit d'une révolte menée par le monde animal dans un camping naturiste.
Si l'on s'en tient à cette première trame, Nord Sentinelle pourrait sembler plus anecdotique que les précédents romans de Jérôme Ferrrari. Il n'en est rien, évidemment, le tourisme n'étant que le prolongement d'un mal plus profond, ce besoin d'asservir, de posséder, de coloniser des terres toujours nouvelles et des corps toujours plus nombreux. Jérôme Ferrari déploie avec une grande virtuosité narrative un dispositif où les motifs se répondent en échos subtils à travers les époques et les continents. Bâti en cinq chapitres, comme les cinq temps de la tragédie, Nord Sentinelle regarde les hommes se débattre avec leur destin, auquel rien ne leur permet d'échapper. Ainsi le narrateur, qui revendique quel qu'en soit le prix le "privilège insoutenable de la lucidité", n'a jamais réussi à quitter cette terre corse à laquelle l'attache un indémêlable noeud d'amour et de haine. "Je le sais, moi qui ai fait tant de vains efforts pour devenir un autre, n'importe qui d'autre que moi, en vérité (...) et je n'ai cependant jamais réussi à devenir étranger à moi-même".
Il est pourtant dans Nord Sentinelle quelques figures qui se sauvent de ce noir désenchantement, et ce sont des figures de femmes: des femmes puissantes et capables de tenir à distance la prédation des hommes. C'est cette adolescente violée par un bandit qui lui fait payer de sa vie l'outrage qu'elle a subi. C'est cette adjudante de gendarmerie submergée par l'irrationnalité de la violence: "il y a bien longtemps qu'elle affronte l'énigme sans plus espérer la résoudre, parce que les mobiles n'éclairent rien et qu'ils ne l'intéressent plus". C'est, surtout, Shirin, jeune étudiante brillante et compagne de la victime, qui avance dans le monde avec assez de lucidité pour s'affranchir du poids du regard des autres.
Nord Sentinelle est un voyage aux sources de la violence, celle des puissants envers les faibles, des hommes envers les femmes, de l'Occident envers le reste du monde. Entremêlant les histoires comme dans un conte oriental, Jérôme Ferrari y déploie toute la palette de son vaste talent.
Disponible en format numérique ici