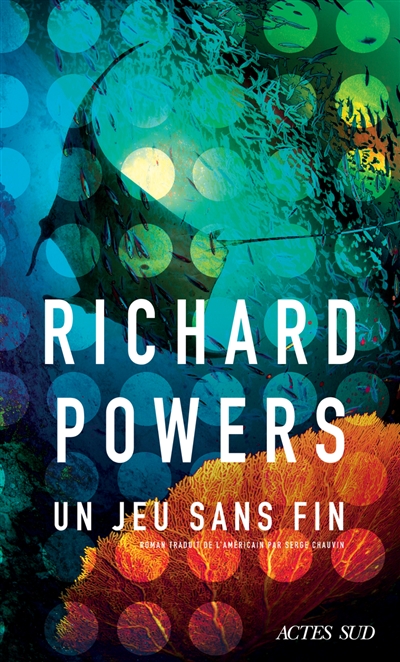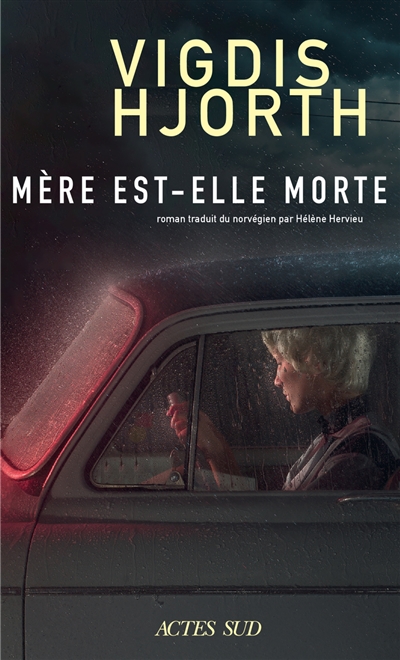Littérature étrangère
La mythologie polynésienne raconte que, lorsqu’il sortit de l’œuf qui l’abritait, le dieu Ta’aroa a créé la terre avec les morceaux de coquille épars. Nous sommes les enfants de ce jeu de construction, et nous aussi nous jouons: "que font toutes créatures sinon jouer sans cesse sur le globe de la terre, jouer devant le Dieu qui les a bricolées ?"
Un jeu sans fin, l’hypnotisant nouveau roman de Richard Powers, explore entre mille et une choses le rapport sacré de l’homme au jeu. On y suit deux ados de Chicago qui scellent leur amitié autour d’un plateau d’échecs. Rafi, né dans les quartiers pauvres, doit à ses brillants résultats scolaires d’être admis dans un collège jésuite huppé. Il y est le seul garçon noir, le seul fils de pompier, le seul à ne devoir à aucune hérédité la place conquise. Sa solitude croise celle de Todd Keane, fils de trader. Tous deux ont grandi auprès de couples dysfonctionnels, tous deux ont connu des blessures et des deuils qu’on ne les a pas aidés à soigner. Les échecs sont leur rédemption. Todd y voit la logique des combinaisons, les codes qui ressemblent à son autre passion dévorante, l’informatique. Pour Rafi c’est tout autre chose: "C’est une histoire. C’est un poème. Putain, c’est Gilgamesh ! Une épopée en devenir". La raison et la passion, le chiffre et la lettre, les pions blancs et les pions noirs: Todd et Rafi sont les faces opposées d’une même pièce.
C’est l’histoire de leur amitié intense, qui durera jusqu’à la fin de leurs études universitaires, que Todd raconte à un mystérieux interlocuteur. Todd est devenu, en l’espace de trois décennies, un patron puissant. Sa plateforme Playground a colonisé les esprits de la planète entière et fait de lui l’un des hommes les plus riches du monde. Il est aussi l’un des grands expérimentateurs de l’intelligence artificielle, alors que son propre cerveau est sur le point de s’effondrer – on vient de lui diagnostiquer une démence à corps de Lowy et il sait sa fin proche.
Autour de cette narration centrale, Richard Powers tresse en virtuose plusieurs autres récits.
Tous sont ancrés dans le Pacifique, et Un jeu sans fin offre une passionnante immersion dans cet "océan plus vaste que tous les continents réunis". Immersion scientifique tout d’abord, sur les traces d’une plongeuse canadienne qui a voué sa vie à l’exploration des fonds marins. Les descriptions des abysses qui s’égrènent tout au long du roman sont d’une beauté et d’une sensualité chavirantes. Comme dans L’arbre-monde ou dans Sidérations, Richard Powers sait donner voix au non-humain et arpente dans les profondeurs un espace romanesque époustouflant. Immersion culturelle et sensible aussi, tout en admiration envers ces peuples pour qui "une pirogue est une île et une île une pirogue". Sans boussole et sans écriture, ils se sont disséminés "sur un tiers du globe plus de mille ans avant que les navires occidentaux les plus perfectionnés n’en effectuent la moindre traversée. Ils formaient le groupe culturel le plus dispersé de la planète. Et toute l’anthropologie, toute la génétique, toute la science historique dont disposait la tribu scientifique (...) étaient incapables de dire comment ils avaient accompli ce prodige". Leurs savoirs, leurs histoires, leurs divinités ouvrent des façons nouvelles et inspirantes de regarder le vivant. Immersion politique enfin, puisque l’océan, les îles qui s’y éparpillent et les savoirs ancestraux polynésiens ont été dévastés par le colonialisme et le soi-disant progrès qui l’accompagne. L’île de Makatea, confetti de la Polynésie française où vivent plusieurs personnages du roman, n’a pas fini d’en faire la sinistre expérience.
Un jeu sans fin éblouit par sa construction éminemment sophistiquée et parfaitement limpide. Le roman s’articule à la fois autour de questions éternelles – l’amour et la trahison, la quête de la beauté, notre rapport au sacré – et d’interrogations brûlantes d’aujourd’hui et de demain – les ravages de l’ultralibéralisme, le néocolonialisme, l’IA, l’inéluctable désastre de l’anthropocène. C’est un récit-gigogne à la richesse et à la ferveur inépuisables. S’il se fait souvent plaidoyer, il n’est jamais manichéen et déjoue tous les pièges en relançant sans cesse les dés et en maniant l’ironie avec brio. Richard Powers, au sommet de sa virtuosité, réserve bien des émerveillements et bien des surprises – les dernières pages d’Un jeu sans fin laissent pantois et rappellent, pour notre plus grande joie, que la fiction aura toujours le dernier mot.
Actes Sud, traduit de l'anglais (États-Unis) par Serge Chauvin, 23.80 €
Disponible en format numérique ici
Depuis D’acier, on sait que Silvia Avallone raconte l’adolescence comme personne – avec la nervosité, le tranchant et le trouble qui disent au plus près cet âge d’entre-deux.
Cœur noir poursuit ce chemin. Son héroïne, Emilia Innocenti, est assurément l’un des plus brûlants personnages croisés chez la romancière.
Quand le roman s’ouvre, Emilia a la trentaine et s’installe dans la maison d’une grand-tante décédée. La maison est depuis longtemps à l’abandon, comme le hameau de montagne auquel elle s’accroche, déserté par des décennies d’exode rural. La solitude convient à Emilia. À Sassaia, ce bout du monde auquel on n’accède qu’à pied au terme d’une montée éprouvante, elle vient chercher un lieu où se tenir à l’abri du passé. "Est-il besoin de dire que si quelqu’un décide de vivre dans un village vidé de ses habitants, c’est qu’il veut laisser derrière lui cette saison de la vie où il se passe des choses. Une saison où les événements vous bouleversent, vous déroutent, vous changent".
Mais la vie réserve des surprises et déjoue les prévisions. À Sassaia, Emilia rencontre Bruno. Il est l’instituteur du village voisin, et lui aussi une âme solitaire. Ses études brillantes auraient pu le mener loin mais il a choisi de revenir sur ces terres oubliées de la modernité, d'enseigner aux enfants, de vivre là avec ses propres fantômes. Emilia et Bruno se ressemblent: "On est des clairs-obscurs. Des trous pleins d’obscurité d’où sortent, parfois, de fortuites déchirures de lumière". L’amour qui naît entre eux, fulgurant et douloureux, est le cœur de ce roman de rédemption. Silvia Avallone peint leur histoire avec une grande intelligence narrative et déploie une cartographie sensible de la passion et du sentiment.
Cœur noir est aussi une passionnante réflexion sur le mal, la faute et le pardon. On ne dira rien des secrets qui rongent Emilia et Bruno, tant leur dévoilement s’avance pas à pas dans le récit et tient en haleine jusqu’à son terme. On peut avancer néanmoins qu’Emilia comme Bruno ont trouvé dans l’art des voies pour panser leurs blessures. Pour lui, la lecture est un compagnonnage essentiel, et les poèmes de Mandelstam comme une fondation sur laquelle tenter de rebâtir ce qui est perdu. Narrateur de Coeur noir, il tâtonne vers la vérité, la sienne et celle d'Emilia. Pour elle, diplômée des Beaux Arts, c'est le dessin qui permet d'approcher les zones en elle que les mots n'atteignent plus depuis longtemps. Elle se laisse guider par des maîtres anciens, l'anonyme dont elle restaure la fresque du Jugement dernier dans l'église d'un village perdu, ou Le Caravage, peintre et assassin, dont les noirs transpercés de lumière l'affolent parce qu'elle y reconnait sa propre part maudite.
Silvia Avallone démêle et retisse avec maestria tous ces fils. Elle a le sens du romanesque, de la tension, des contrastes: "aucun de nous ne contient une seule personne". Elle y ajoute l'énergie rageuse d'un roman social qui ne craint pas de souligner les lignes de front et la violence des dominations. Sa langue est joueuse, elle capture au plus juste dans ses filets les registres, les intonations, les expressions de chacun·e de ses personnages, qui sont nombreux et tous épatants de vérité. La lecture de Coeur noir est ébouriffante, elle affute sens et pensées, rassemble les énergies. Résilients, résistants, obstinés, Emilia et Bruno tirent de leurs adolescences saccagées ce secret universel: "tant que tu es vivant, tu dois".
Liana Levi, traduit de l'italien par Lise Chapuis, 23 euros
Disponible en format numérique ici
Il y a longtemps que Johanna est partie.
Trente ans se sont écoulés depuis qu’elle a quitté mari, famille, pays natal pour suivre un homme follement aimé et pour devenir l’artiste qu’elle n’aurait pu être sans rompre des amarres trop lourdes. Johanna a fait sa vie aux États-Unis. Elle est désormais une artiste reconnue. Sa peinture, qui questionne la famille et la figure maternelle, est à la fois enracinée dans son histoire intime et profondément universelle.
Pendant ces trente années, Johanna n’est jamais retournée en Norvège. Ses relations avec ses parents et sa sœur se sont lentement étiolées, puis définitivement brisées lorsqu’elle a choisi de ne pas rentrer à la mort du père. Le temps a beau passer, il n’efface pas le poids du chagrin et du déchirement. Aussi, lorsqu’elle est invitée en Norvège pour une rétrospective de son œuvre, Johanna sait qu’elle va aussi tenter de recoller les éclats tranchants de son histoire familiale.
À près de soixante ans, Johanna a encore du mal à se définir autrement que fille ou sœur, « parce que nous sommes des entités mythologiques les unes pour les autres, et parce que nous sommes ennemies, qui n’est pas curieux de son ennemi ». Un soir, elle tente d’appeler sa mère. Celle-ci ne décroche pas. Commence alors une traque épousant de plus en plus les contours de l’obsession: Johanna en planque devant l’immeuble de sa mère; Johanna suivant les dames âgées dans la rue; Johanna espionnant sa mère et sa sœur en visite sur la tombe du père; Johanna traquant le flux des souvenirs imprécis qui remontent depuis l’enfance.
Partant de ce matériau fragile, Johanna invente les vies possibles de cette mère qui l’a bannie. « Que des enfants renient leurs parents est compréhensible, que des parents renient leurs enfants, et de manière si intraitable, est rare ». À tâtons, Johanna s’interroge sur ce qu’il reste en elle de son enfance, sur la manière dont l’art l’aide à « arracher le bandeau de [ses] yeux ». Son monologue s’écrit en chapitres brefs, crus, haletants. Le blanc de la page souligne la solitude insondable de cette femme blessée.
Devant l’atelier qu’elle a installé en forêt le temps de son séjour norvégien, Johanna croise souvent un élan. Bête massive, primitive, qui prend l’habitude de s’installer face à elle et semble voir en elle des choses qu’elle-même a du mal à discerner. Un jour l’élan si paisible est devenu comme fou. Il court à perdre haleine, fracasse sa tête contre les arbres, arrache violemment sa ramure trop lourde: « Cela ressemblait à de l’automutilation et à de l’autodestruction frustrées ou à une protestation contres les conditions de vie sur terre ». Puis les derniers bois tombent et l’élan retrouve son calme, libéré. C’est ce même travail qui attend Johanna: malgré la douleur, s’extraire d’une ramure qui l’enferme depuis trop longtemps.
De cette intrigue ténue – une mère, une fille, la pelote inextricable de leurs relations – Vigdis Hjorth tire un roman fascinant et captivant, douloureux mais aussi empreint d’ironie, voire d'une forme de fantaisie décalée. Mère est-elle morte est une exploration d’une grande perspicacité de l’âme humaine et de ses tourments.
Actes Sud, traduit du norvégien par Hélène Hervieu, 23.50 euros