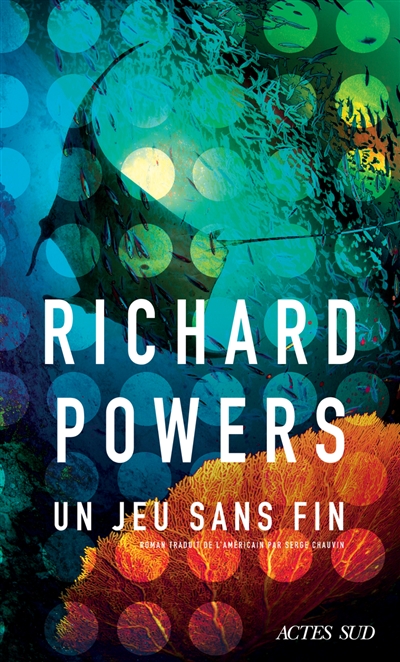La mythologie polynésienne raconte que, lorsqu’il sortit de l’œuf qui l’abritait, le dieu Ta’aroa a créé la terre avec les morceaux de coquille épars. Nous sommes les enfants de ce jeu de construction, et nous aussi nous jouons: "que font toutes créatures sinon jouer sans cesse sur le globe de la terre, jouer devant le Dieu qui les a bricolées ?"
Un jeu sans fin, l’hypnotisant nouveau roman de Richard Powers, explore entre mille et une choses le rapport sacré de l’homme au jeu. On y suit deux ados de Chicago qui scellent leur amitié autour d’un plateau d’échecs. Rafi, né dans les quartiers pauvres, doit à ses brillants résultats scolaires d’être admis dans un collège jésuite huppé. Il y est le seul garçon noir, le seul fils de pompier, le seul à ne devoir à aucune hérédité la place conquise. Sa solitude croise celle de Todd Keane, fils de trader. Tous deux ont grandi auprès de couples dysfonctionnels, tous deux ont connu des blessures et des deuils qu’on ne les a pas aidés à soigner. Les échecs sont leur rédemption. Todd y voit la logique des combinaisons, les codes qui ressemblent à son autre passion dévorante, l’informatique. Pour Rafi c’est tout autre chose: "C’est une histoire. C’est un poème. Putain, c’est Gilgamesh ! Une épopée en devenir". La raison et la passion, le chiffre et la lettre, les pions blancs et les pions noirs: Todd et Rafi sont les faces opposées d’une même pièce.
C’est l’histoire de leur amitié intense, qui durera jusqu’à la fin de leurs études universitaires, que Todd raconte à un mystérieux interlocuteur. Todd est devenu, en l’espace de trois décennies, un patron puissant. Sa plateforme Playground a colonisé les esprits de la planète entière et fait de lui l’un des hommes les plus riches du monde. Il est aussi l’un des grands expérimentateurs de l’intelligence artificielle, alors que son propre cerveau est sur le point de s’effondrer – on vient de lui diagnostiquer une démence à corps de Lowy et il sait sa fin proche.
Autour de cette narration centrale, Richard Powers tresse en virtuose plusieurs autres récits.
Tous sont ancrés dans le Pacifique, et Un jeu sans fin offre une passionnante immersion dans cet "océan plus vaste que tous les continents réunis". Immersion scientifique tout d’abord, sur les traces d’une plongeuse canadienne qui a voué sa vie à l’exploration des fonds marins. Les descriptions des abysses qui s’égrènent tout au long du roman sont d’une beauté et d’une sensualité chavirantes. Comme dans L’arbre-monde ou dans Sidérations, Richard Powers sait donner voix au non-humain et arpente dans les profondeurs un espace romanesque époustouflant. Immersion culturelle et sensible aussi, tout en admiration envers ces peuples pour qui "une pirogue est une île et une île une pirogue". Sans boussole et sans écriture, ils se sont disséminés "sur un tiers du globe plus de mille ans avant que les navires occidentaux les plus perfectionnés n’en effectuent la moindre traversée. Ils formaient le groupe culturel le plus dispersé de la planète. Et toute l’anthropologie, toute la génétique, toute la science historique dont disposait la tribu scientifique (...) étaient incapables de dire comment ils avaient accompli ce prodige". Leurs savoirs, leurs histoires, leurs divinités ouvrent des façons nouvelles et inspirantes de regarder le vivant. Immersion politique enfin, puisque l’océan, les îles qui s’y éparpillent et les savoirs ancestraux polynésiens ont été dévastés par le colonialisme et le soi-disant progrès qui l’accompagne. L’île de Makatea, confetti de la Polynésie française où vivent plusieurs personnages du roman, n’a pas fini d’en faire la sinistre expérience.
Un jeu sans fin éblouit par sa construction éminemment sophistiquée et parfaitement limpide. Le roman s’articule à la fois autour de questions éternelles – l’amour et la trahison, la quête de la beauté, notre rapport au sacré – et d’interrogations brûlantes d’aujourd’hui et de demain – les ravages de l’ultralibéralisme, le néocolonialisme, l’IA, l’inéluctable désastre de l’anthropocène. C’est un récit-gigogne à la richesse et à la ferveur inépuisables. S’il se fait souvent plaidoyer, il n’est jamais manichéen et déjoue tous les pièges en relançant sans cesse les dés et en maniant l’ironie avec brio. Richard Powers, au sommet de sa virtuosité, réserve bien des émerveillements et bien des surprises – les dernières pages d’Un jeu sans fin laissent pantois et rappellent, pour notre plus grande joie, que la fiction aura toujours le dernier mot.
Actes Sud, traduit de l'anglais (États-Unis) par Serge Chauvin, 23.80 €
Disponible en format numérique ici