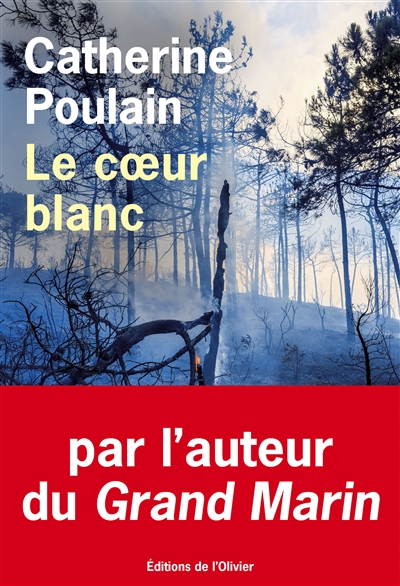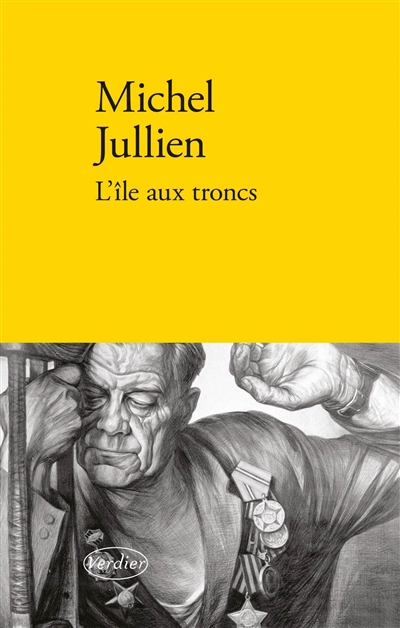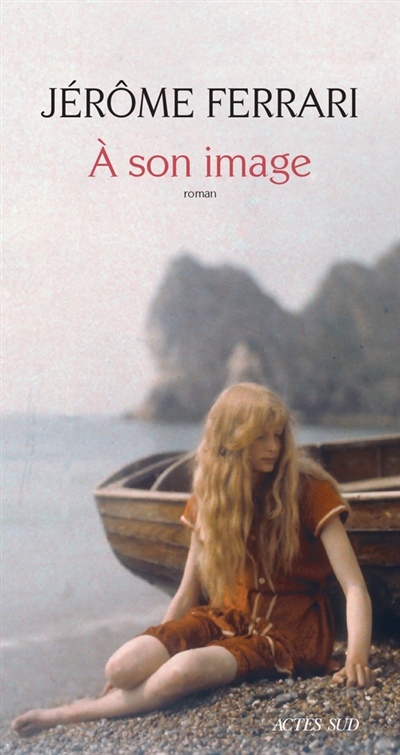Dans son premier roman, " Le Grand Marin " (2016, L’Olivier ; sorti en poche chez Points/Seuil), Catherine Poulain nous faisait embarquer à bord du Rebel, un bateau de pêche naviguant en Alaska. Surnommée « Moineau » par l’équipage, des hommes rudes et taiseux, Lili, la narratrice, avait fui le confort d’une vie douillette pour prendre la route – comme on prend le maquis. Frêle mais forte, armée jusqu’aux dents d’une détermination farouche, la jeune femme ne ménageait pas sa peine et gagnait le respect de ses compagnons – dont l’un d’eux, un jour, devenait plus qu’un camarade et menaçait de la faire dévier de son cap sauvage et solitaire.
Cette fois, c’est dans la vie des saisonniers, ces « abricots du rebut », que nous sommes plongés, aux côtés de Rosalinde et de Mounia. La première est férocement éprise de sa liberté – comme Lili – ; la seconde est dévorée par une faim insatiable – « désir insupportable de plus grande brûlure ». Animées d’une âpre volonté et d’une énergie qui sourd du fond des tripes, elles souquent dur et boivent sec. Elles semblent irréductibles – mais sont tendues à craquer.
Inspiré lui aussi par les pérégrinations de l’auteure – qui a connu la vie des saisonniers et celle des pêcheurs –, "Le Cœur blanc" est, comme elle le précise, une fresque : celle d’un monde que nous ne connaissons guère, voire pas du tout, et qu’elle dépeint sans fard ni complaisance, avec une justesse crue et une tendresse pleine d’empathie. Elle raconte la sélection, à l’aube, de ceux qui pourront travailler ; la besogne lourde et ingrate, les insultes et le mépris de certains patrons ; la misère et la crasse où croupissent les chemineaux – qui dans une grange, qui dans un cabanon qu’on lui prête le temps de la récolte, qui dans un vieux combi, … – ; les soirées et les nuits où ils s’abrutissent d’alcool pour oublier leur épuisement et tenter, vainement, de combler le vide ; la déchéance sordide où certains tombent.
Au cœur de cette histoire, le corps. Le corps suant et peinant, éreinté et abîmé par le travail, la boisson ou la drogue ; le corps souffrant ou exultant sous les coups ou les caresses d’une nature tantôt âpre et hostile, tantôt douce et généreuse ; le corps ardent, aussi – surtout –, désiré et désirant, dont l’auteure, dans une langue vive, emportée et irradiée, chante la beauté et la force, les appétits et les joies. Le corps fauve et brutal, enfin, quand le désir devient machine infernale et sombre dans la violence.
Roman puissant, incandescent et charnel, "Le Cœur blanc" pose aussi la question du sens à donner à sa vie – où et comment le trouver, dans le ressac sans trêve du désespoir qui terrasse et de la fièvre qui exalte ? –, de l’identité et des racines, et de la liberté : est-on libre quand on appartient à la race des trimardeurs, des sans-terres et sans-attaches ? Quand on est dévoré par une faim furieuse d’on ne sait trop quoi, toujours sur le point de crever d’inanition, qu’on boit à tomber pour rester debout – et qu’on sait « qu’on traîne ça comme un boulet » ?
Piotr, cul-de-jatte, et Kotik, unijambiste et manchot, sont des mutilés de la Seconde Guerre Mondiale. Après leur convalescence, ils se font mendigots et tournent poivrots, imbibés du matin ou soir et inversement de samogon, vouant un culte à Natalia Mekline, une héroïne de l’aviation russe, et rapetassant vétilleusement une lettre adressée au commissaire à la Santé, dans l’espoir – vain – de voir s’étoffer un peu leur maigre pension.
En 1950, au bord de la faillite – les affaires vont mal depuis la fin de la guerre : des hordes de mutilés crapahutant ont rejoint les villes ; la concurrence est rude et leur misère, banalisée, ne fait plus recette – les deux amis échouent, avec d’autres camarades, sur l’île de Valaam, à l’extrême nord du lac Ladoga, près de la Finlande, où le pouvoir a décidé de déporter les samovary – c’est ainsi qu’on les surnomme – à des fins esthétiques et idéologiques : ces éclopés font tache dans les rues d’une Union soviétique en pleine effervescence. Là-bas, dans un monastère désaffecté, au milieu de quelques centaines d’infirmes, dans la crasse et le froid, Piotr et Kotik, après avoir terminé leur laborieuse missive, élucubrent, toujours pochetronnant, le projet fou de quitter leur retraite pour aller à la rencontre de leur idole …
Le roman s’ouvre sur un panorama de la Cour des miracles qu’est l’île de Valaam, et dresse un catalogue de portraits truculents, pages d’Histoire et de tératologie mêlées, avant de se fixer sur les compères Piotr et Kotik, et de dévider leur histoire, depuis leur enrôlement jusqu’à leur relégation dans ce purgatoire des déglingués.
Dès les premières pages, le ton est donné, et le lecteur happé : nul pathos, aucune pitié convenue ; pas non plus de cynisme ni de complaisance. Au contraire : un style enlevé et vigoureux, mêlant avec verve langue populaire et langue châtiée, relevé çà et là de termes rares et usant parfois d’anachronismes incongrus mais expressifs – ainsi, les samovars ont des faciès de smileys. Grâce à cette écriture âpre et acérée, d’une grande précision, à un sens aigu du détail et à un subtil humour noir, Michel Jullien nous plonge, avec empathie, dans l’intimité de ses héros, au plus près de leur déchéance physique et morale, et donne à ces « rabroués de l’armée » une voix, une figure et – presque – un corps.
À la force du style s’ajoutent l’intérêt et l’originalité du sujet : il s’agit là d’un un épisode mal connu et peu documenté de l’histoire soviétique, que le mythe et la légende ont amplifié : comme le précise la postface, des vétérans en bringues ont bien été invités à se rendre sur l’île de Valaam, mais il n’est pas possible d’affirmer, dans l’état actuel des connaissances, qu’une vaste et nationale entreprise de déportation des mutilés de guerre ait été menée.
Quoi qu’il en soit, avec L’île aux troncs, farce grinçante, charge et satire et, si je puis dire, contre-épopée beckettienne, l’auteur, mêlant habilement le grotesque et le tragique, nous livre un roman singulier et de haute qualité, aussi saisissant que poignant.
Depuis 2001 et la parution de son premier livre, Variations sur la mort, Jérôme Ferrari construit une œuvre incontournable dans le panorama de la littérature française contemporaine. Couronné par le Prix Goncourt pour Le sermon sur la chute de Rome (Actes Sud, 2012), Jérôme Ferrari s'interroge de livre en livre sur la façon dont les mondes se défont et finissent par disparaître. La beauté sombre et désenchantée de l'écriture, les questionnements philosophiques (notamment autour du mal et de sa représentation), le travail de mémoire et la relation puissante à la terre corse: autant de fils rouges qui courent à travers une œuvre profondément cohérente.
À son image, qui paraît aujourd'hui, est un livre à la richesse infinie, qui tresse de nombreuses lignes de force et de tension, des destinées multiples, des éclats de réalité dans le tissu de la fiction. Et ce tressage est serré, ramassé, comme le titre du livre qui en trois petits mots condense bien des significations et bien des résonances.
Le roman propose une passionnante réflexion sur l'image, et singulièrement l'image photographique. On connaît l'intérêt de Jérôme Ferrari pour cette thématique: c'est sur la contemplation d'une photographie que s'ouvrait Le sermon sur la chute de Rome. En 2015, dans À fendre le coeur le plus dur, écrit à quatre mains avec Oliver Rohe, Jérôme Ferrari posait, à partir des photos de Gaston Chéreau sur la guerre italo-lybienne de 1911, la question éminemment contemporaine de la représentation de la violence, entre nécessité de témoigner et obscénité de représenter.À son image poursuit donc un chemin arpenté depuis longtemps par Jérôme Ferrari. Il le fait en choisissant de recourir à la fiction.
Au centre du livre, un formidable portrait de femme. Antonia naît en Corse, dans les années 1960. Parce qu'elle se passionne pour les photos de famille, son oncle et parrain lui offre un appareil photo pour ses 14 ans. C'est l'instant décisif, qui décidera de sa vie entière. Après des études avortées à Nice, Antonia rentre en Corse et trouve, grâce à son oncle encore, un poste de reporter photo dans un journal local. Dans les années '90, lassée de l'insignificance de son travail quotidien, elle prend un long congé pour se rendre dans la Yougoslavie en guerre. Elle voudrait par ses photos rendre compte, éveiller les consciences, être comme les photographes qu'elle admire "utile, courageuse et obstinée".
Mais Antonia n'est pas seulement une photographe, c'est aussi une fille, une soeur, une femme amoureuse, dont nous suivons le long et parfois douloureux chemin vers l'affranchissement dans une Corse au virilisme omniprésent. Les relations d'Antonia et ses proches sont aussi un des axes du livre, et notamment la relation la plus intime, la plus conflictuelle, la plus passionnée: celle qui la lie à son oncle et parrain, qui est aussi prêtre, et à qui revient cette tâche impossible de célébrer les funérailles d'Antonia.
Car Antonia meurt, à 38 ans, dans les premières pages du roman. Elle qui a tant regardé, elle meurt d'un éblouissement, qui emporte sa voiture dans un ravin de l'Ostriconi. C'est à déplier toutes les vies d'Antonia que s'emploie le roman, épousant la structure de la messe de ses funérailes.
Roman d'un échec, roman du doute et de la désillusion, À son image est un livre intense et poignant, construit selon un dispositif narratif imparable. Jérôme Ferrari y fait éprouver à chacun de ses lecteurs tout le tragique de la condition humaine.