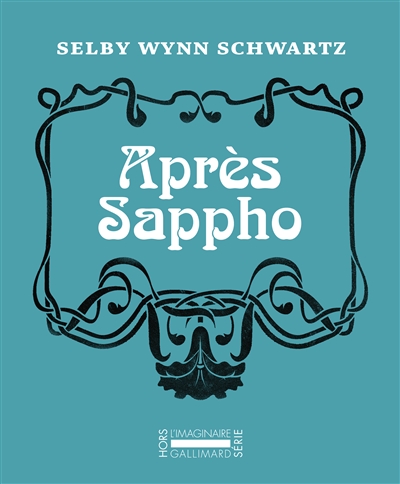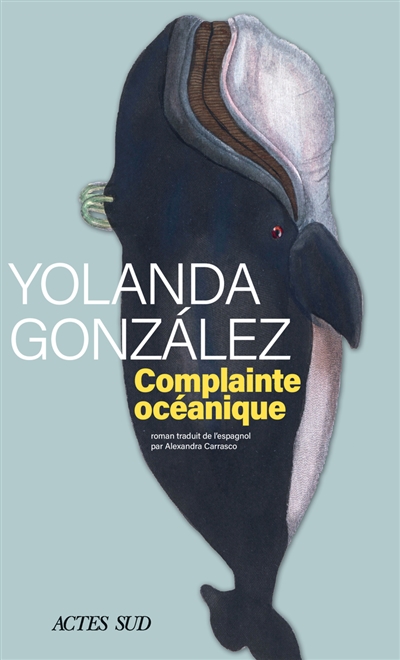Littérature étrangère
Souvenez-vous de ce que nous avons fait
Du temps de notre jeunesse
Oui, tant de douces choses
Des poèmes de Sappho ne restent que des fragments. Éclats de beauté qui fascinent par-delà les siècles et trouvent dans ce livre singulier une résonance spectaculairement moderne.
Après Sappho tisse des vies de femmes au tournant des 19e et 20e siècles. Toutes ont en commun d’avoir soif d’un monde nouveau, d’une place qui ne serait pas subalterne dans un monde modelé pour les hommes. Elles viennent du monde ouvrier ou de la haute aristocratie ; elles sont françaises, anglaises ou italiennes ; certaines nous sont familières quand les autres sont oubliées ou inconnues – peu importe, dans ce livre elles sont des sœurs, nos sœurs. Leur nous court à travers tout le livre, prête aux vies de chacune un même corps, un même chœur, et invite le lecteur à y prendre sa part. Notre premier acte a été de changer de nom. Nous allions devenir Sappho.
On croise au fil des pages Isadora Duncan et Colette, Renée Vivien et Natalie Barney, Sarah Bernhard, Djuna Barnes, Vita Sackville-West, Eillen Gray et Virginia Woolf bien sûr, qui est comme le miroir contemporain de Sappho. Woolf dont le père avait écrit un Dictionary of National Biography, monumentale entreprise pour raconter la gloire des grands hommes, et qui a subverti ce genre étriqué de la biographie en écrivant Orlando, récit d’une vie mouvante dans le lieu, l’époque, le genre.
La façon qu’a Selby Wynn Schwartz de raconter toutes ces femmes s’apparente au modèle woolfien : mouvant, fluide, tout à la fois éclaté et limpide. Au gré des 20 chapitres d’Après Sappho, eux-mêmes décomposés en scènes brèves, la chronologie n’est pas de mise, et aucune autre logique pour passer d’un paragraphe à un autre que la circulation du désir et de la lumière. Cela donne un livre ne ressemblant à nul autre, vertigineux par son érudition mais joueur, inventif, transgressif comme ces femmes qui ont fait exploser les carcans de leur époque.
Et puis il faut dire un mot de l’objet livre, sublime écrin à ce texte hors-normes. Le format, le papier, le jeu des couleurs, les arabesques des marges, les illustrations végétales qui séparent les chapitres, les clins d’œil à l’art nouveau: tout est beau, soigné, pensé pour que la forme approfondisse l’expérience du fond.
Un livre-trésor, dont on n’a jamais fini l’exploration.
Gallimard, L'Imaginaire, traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène Cohen, 25 euros
Cette Complainte océanique, c’est un chant épique avec ce qu’il faut de souffle, de colère, de tragédie et de poignante beauté pour tenir les lecteurs captifs d’un bout à l’autre de la traversée.
Yolanda González déplie dans ce roman une histoire longue de cinq siècles mais dont les origines plongent dans la nuit des temps: celle de la fascination des hommes pour les baleines. Une fascination née dans la terreur inspirée par le Léviathan biblique, qui se mue ensuite en obsession belliqueuse lorsque la chasse à la baleine permet l’essor de l’économie capitalistique moderne puis bascule dans la nostalgie à mesure que nous prenons conscience des ravages irréversibles infligés à la vie des océans par des siècles de prédation.
Yolanda González raconte cette histoire depuis sa terre d’adoption, le Pays Basque, qui a longtemps été l’avant-poste de la chasse à la baleine. Au XVIe siècle, toute l’économie locale tourne autour des baleines harponnées. Mais règne alors une forme d’éthique – les baleiniers ont leurs secrets, leurs rituels, et le sang de l’animal se paie cher en sang humain versé. Bientôt, la chasse à la baleine va susciter de telles convoitises que l’équilibre se rompt. Au nom du progrès et de la civilisation, la chasse devient extermination. L’hubris des hommes ne connaît pas de limite: "être tout, tout posséder, tout habiter, tout voir, tout dévorer."
Sur cette trame historique, Yolanda González tisse un second récit, ancré pour sa part dans notre aujourd’hui. Alors qu’un G7 se prépare à Biarritz et que la ville est assiégée par les forces de l’ordre, une baleine vient s’échouer sur la plage. Son agonie sème le désordre. A-t-elle été orchestrée par les associations écologistes qui tentent de tenir un contre-sommet ? Que dit de notre monde la présence du cétacé, mort des blessures infligées par des cargos, de la faim suscitée par la surpêche, de l’empoisonnement lent à cause du plastique ingéré, de l’absence de protection jusque dans des eaux normalement sanctuarisées ?
Complainte océanique fait se croiser autour de la baleine échouée les destins de personnages complexes, militants, scientifiques, journalistes, pêcheurs. Tous voient leurs certitudes vaciller, leur quotidien comme sorti de ses gonds, dans cette brutale confrontation avec la mort. Car une question hante le livre, celle d’un destin lié de l’homme et de l’animal.
« Vous. / Nous ».
Yolanda González ne donne pas de leçon, ne tient pas de grands discours. Elle nous fait simplement éprouver, par l'intensité et la force incantatoire de sa langue, où les outrances humaines mènent la planète et ceux qui y vivent.
ActesSud, traduit de l'espagnol par Alexandra Carrasco, 23 euros
C’est un livre hénaurme mais il ne faut pas en avoir peur : un peu plus de 700 pages pour 52 chapitres, sa lecture vous prendra un peu moins de deux mois à raison de moins de 15 pages par jour et la satisfaction et certitude d’avoir lu un beau et grand livre, pas mal, non ?
On y parcourt le 19ème siècle croate avec l’histoire de la sorcière Gila qui à travers sa fuite en avant avec l’impératrice d’Autriche qu’elle doit faire avorter, vit bien des aventures, bien des tourments.
Želimir Periš nous embarque dans cette fresque haute en couleur – roman picaresque post-moderne et féministe comme le décrit justement l’éditeur – et joue avec nous, lecteur.ice.s, et parfois se joue de nous, par des changements de rythme, d’atmosphère, d’espace-temps. Chaque chapitre est introduit par un incipit sous la forme d’un poème ou d’une comptine nous annonçant la morale de ce que nous allons lire ainsi que d’un bref résumé des actions à venir.
C’est un roman pétillant, ludique, malin qui, avec des historiettes cocasses, rocambolesques, burlesques, assemblées comme un puzzle, par fragments, développe un discours moderne et fin sur la place des femmes dans la société, sur la couardise et l’autorité intempestive des hommes, sur les croyances aussi et les superstitions mais aussi et surtout sur la liberté, l’insoumission. 
Un grand livre, dans tous les sens du terme !
Les éditions du Sonneur, traduit du croate par Chloé Billon, 27.50 €