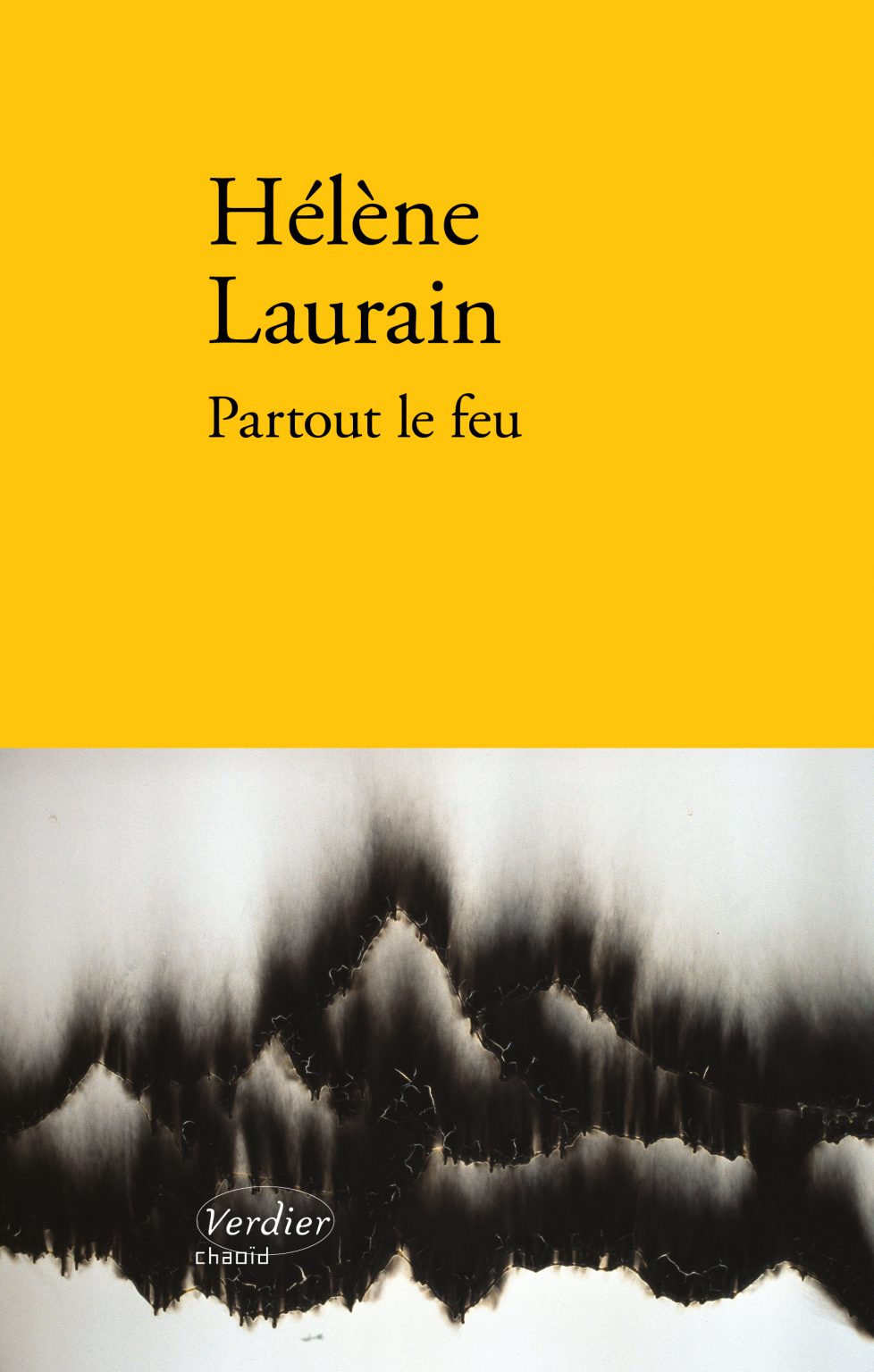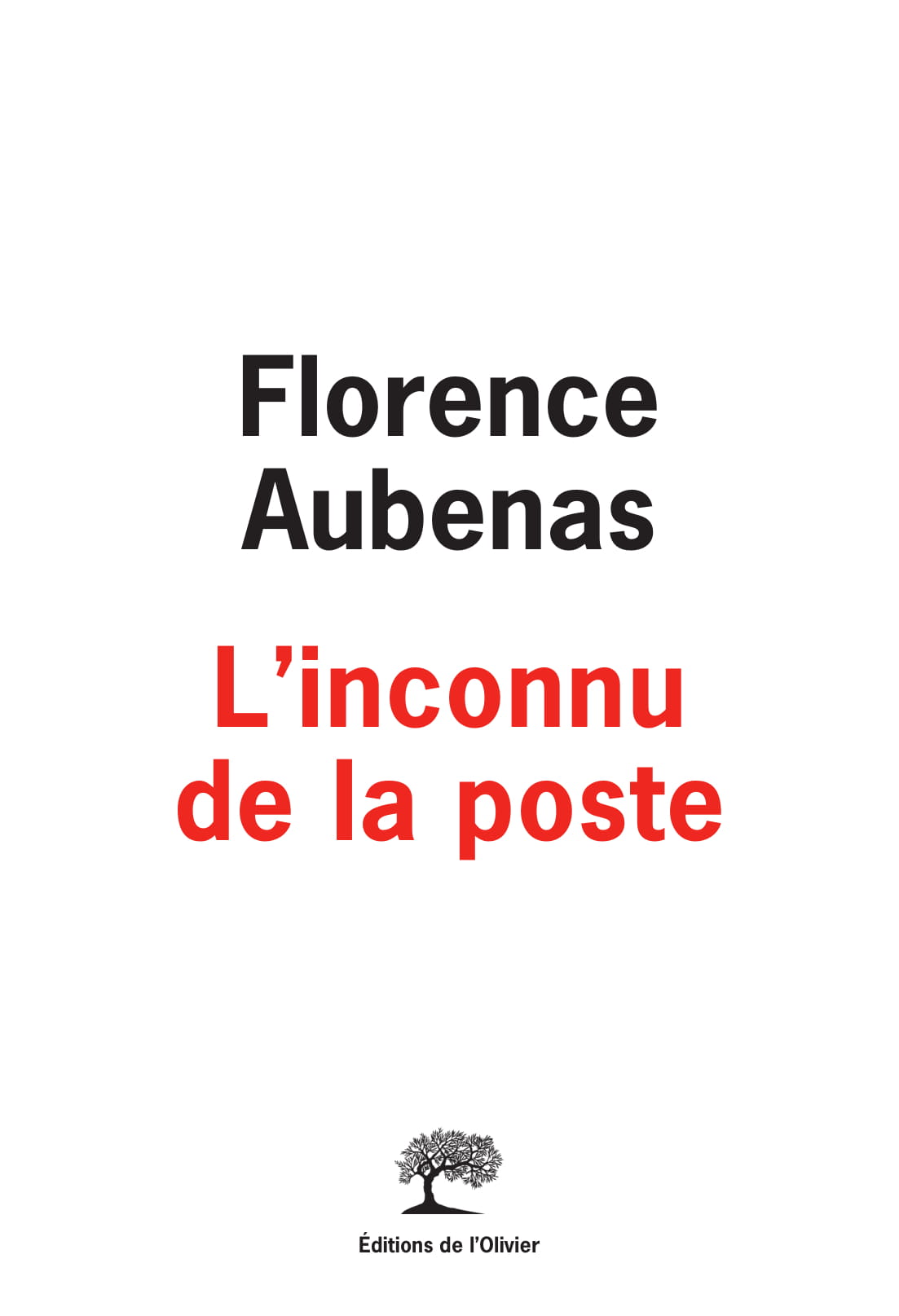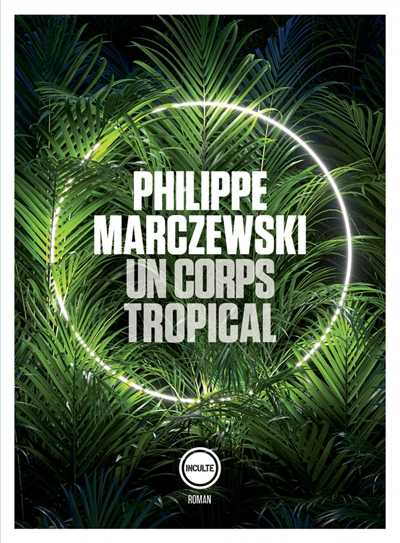Un feu d’artifice pour ouvrir le livre, un grand incendie pour le refermer, et entre les deux "Partout le feu" crépite, flamboie, illumine comme rarement la colère de notre temps.
Avec ce premier roman écrit d’un souffle, Hélène Laurain raconte les désirs, les espoirs et les peurs de Laetitia, née dans l’Est triste quelques minutes avant l’explosion de Tchernobyl. La vie de Laetitia est aussi fissurée que le réacteur nucléaire. Le deuil impossible d’une mère partie trop tôt, l’absurdité de son travail, le sentiment oppressant de la catastrophe climatique: sa vie implose, et les post-it implacables ou poétiques qu’elle griffonne méthodiquement ne suffisent pas à l’étayer.
Alors, l’énergie libérée par tant de failles, Laetitia la met au service d’un groupe d’activistes écologistes. De coups d’éclats en gardes à vue, elle garde intacte sa conviction: brûler de douleur et faire avec.
Drôle et rageuse, habitant une vertigineuse solitude, Laetitia mesure les progrès de son eczéma sans pour autant renoncer à traquer la beauté du monde. C’est une héroïne bien d’aujourd’hui, délurée, sans illusion mais pas sans idées, une Antigone pour nos temps effondrés.
ma couleur c’est le vert / vert sorcière / vert colère / vert furie
Disponible en format numérique ici
Florence Aubenas est une journaliste hors du commun. Du Rwanda à l’Irak, de l’Algérie à Outreau, elle traque le réel au plus près, attentive aux soubresauts et aux chuchotements, à l’ordinaire qui cache souvent sa part d’extraordinaire.
Depuis son formidable « Quai de Ouistreham » paru en 2010 aux éditions de l’Olivier, nous savons qu’elle est aussi une immense écrivaine, et « L’inconnu de la Poste » le confirme avec éclat.
Captivant de bout en bout, haletant comme les meilleurs polars, « L’inconnu de la Poste » tente de démêler l’écheveau de faits et de rumeurs tissé autour du meurtre d’une postière dans une petite ville des Alpes françaises. Patiemment, Florence Aubenas rassemble les pièces d’un puzzle à l’incroyable complexité. Son sens du détail et de la mise en scène, doublé d’un art épatant du montage, transforment cette affaire en un passionnant portrait de notre société. L’empathie et la générosité de Florence Aubenas offrent à chacun des protagonistes une dignité et une densité profondément émouvantes.
« L’inconnu de la Poste » est de ces livres qui nous habiteront longtemps. En nous maintenant sur le fil ténu entre le banal et le tragique, il réinvente le journalisme littéraire et explore de nouveaux territoires d’écriture.
Éditions de l'Olivier, 19 euros
Disponible en format numérique ici
Oubliez le froid et les cieux trop bas, oubliez la routine et ses soucis: les pas si tristes tropiques de Philippe Marczewski vont vous euphoriser!
"Un corps tropical" est une épopée truculente. On y suit un homme à la vie terne et banale, sauvé de l'ennui par les heures qu'il passe – en secret et maillot fleuri – dans la piscine à bulles d'un parc tropical de banlieue. Cette passion inavouée finira par le mener, dans une succession de quiproquos savoureux, aux confins de la forêt amazonienne, Et notre "aventurier d'agrément", jouet d'un destin qui semble trop grand pour lui, finira par se forger le corps tropical auquel il a tant aspiré: "et je me suis dit que c’était sans aucun doute ça, cette sensation-là, les tropiques, cette sensation de glissements sans heurt, et que la tropicalité était une question de fluidité, voilà, de fluidité me suis-je dit".
Cela passe par un faux voyage à Rome, une biture héroïque à Madrid ("nous bâtissions une ivresse monumentale, sa forme s'élevait rapidement, on la verrait de loin, une ivresse dont on fait les légendes et dont le souvenir se raconte comme une épopée, longtemps après"), un attaché-case à livrer à Lima, le tout au rythme hypnotique de la cumba et du reggaeton. Lorsqu'il débarque à Iquitos, notre héros pense ne pouvoir aller plus loin: "j'étais au point où la balle du jokari a tendu l'élastique presque jusqu'à le rompre et revient avec force vers la main qui l'a frappée"; mais il se trompe, évidemment. Il n'est pas au bout de ses surprises, et nous non plus...
Sous les péripéties tragicomiques, "Un corps tropical" ne manque pas de lucidité et égratigne notamment le rapport au monde étriqué de l'homme blanc: "les plantes à larges feuilles et les chants d'oiseaux enregistrés et les eux chaudes du jacuzzi de la piscine du parc tropical n'étaient qu'un décor de théâtre, tandis que la vérité tropicale, c'étaient ces rues poussiéreuses, ces casses automobiles et cette pollería". Car notre héros en fera l'expérience, les tropiques sont terres de fantômes, et les dangers qui y guettent l'aventurier pas toujours ceux que l'on croit.
Se jouant des clichés et des attendus du roman d'aventure, Philippe Marczewski signe un livre inclassable, joyeux et mélancolique, totalement addictif. Son écriture déploie toute la palette de l'humour et de l'ironie et le place dans le sillage de glorieux prédécesseurs, de Mathias Énard à Éric Chevillard et son "Oreille rouge". Ils partagent la fausse ingénuité, le sourire malin, la générosité et surtout la réflexion sur ce que c'est que l'aventure aujourd'hui, au bout du monde ou au bout de la rue: "mais enfin, il faut tout de même survivre pour que cela devienne une aventure, me suis-je dit. Il faut survivre et raconter; l’aventure n’en devient une que parce qu’on en fait le récit, sinon c’est la vie et ses péripéties, rien d’autre; combattre l’alligator affamé ne vaut rien si on n’atteint pas la berge sain et sauf et qu’on ne trouve pas un public à qui narrer sa lutte".
Disponible en format numérique ici