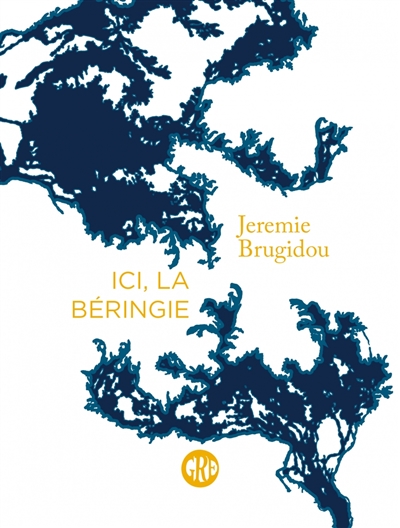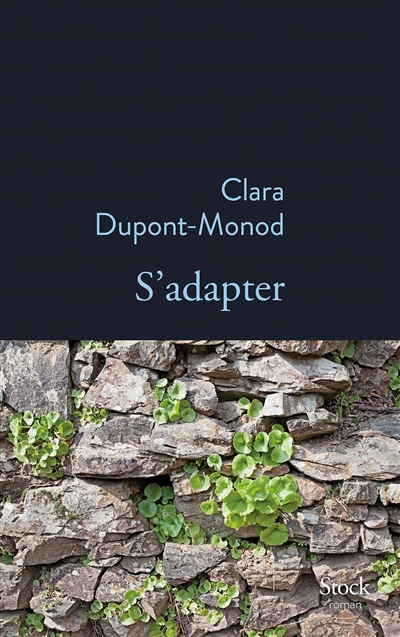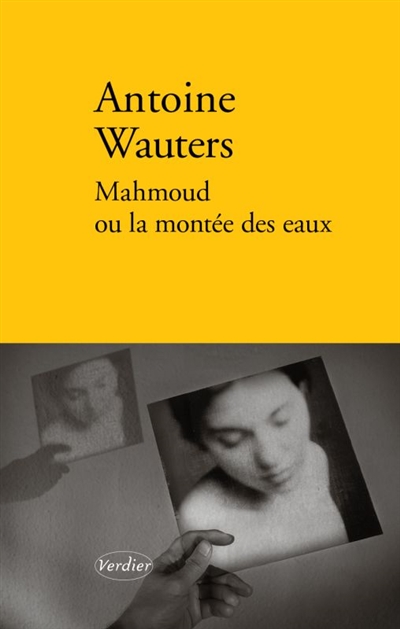Comme on déploie une carte, déplier les temps.
Comme l'esprit vagabonde en rêvant aux terres lointaines, lâcher la bride à l'imaginaire des temps, du passé le plus reculé au futur indéchiffrable.
Sur ce double fil géographique et historique s'avance le premier roman de Jeremie Brugidou, et il tient en équilibre avec ce qu'il faut d'audace, de détermination, d'acceptation du vacillement.
La Béringie est une terre engloutie entre l'Alaska et l'Extrême-Orient russe. Endormie sous les eaux de Détroit de Béring, elle n'en palpite pas moins de vie, de mystères, d'enjeux. "Ici, la Béringie" tisse trois époques de cette terre. Le livre s'ouvre sur une vision du futur lorsque, dans quelques décennies, le permafrost a fondu des deux côtés du Détroit et qu'une archéologue tente de rendre la parole aux vestiges surgis de sous la glace. Geste de sauvetage marqué par l'urgence tant l'exploitation des richesses géologiques et touristiques des lieux risque d'arracher ces sites au patrimoine de l'humanité bien plus définitivement que leur séjour millénaire dans le sol gelé.
En contrepoint s'écrit une autre odyssée scientifique, située dans les premiers temps de la Guerre Froide. Alors que Soviétiques et Américains se disputent la suprématie sur ces zones-frontières, un botaniste cherche à trouver dans les pollens fossilisés de part et d'autre du Détroit les traces d'une terre commune. Une femme-chamane éperdument aimée et tragiquement perdue le guide dans son cheminement, qui n'est peut-être pas tant scientifique qu'intime.
À ces pisteurs du vivant que sont l'archéologue et le botaniste, Jeremie Brigidou fait répondre une voix venue du fond des temps, celle d'une jeune femme Qui-Collecte dont les savoirs et les intuitions résonnent avec les interrogations d'aujourd'hui et de demain. Parce que le désastre de son époque à elle, celle de la montée des eaux qui engloutit la Béringie et efface tous les repères, est à la hauteur des catastrophes de notre temps à nous, la confiance, la détermination et la créativité de cette passeuse de mondes vieille de dix mille ans nous éclairent, lueurs fragiles mais agissantes.
L'entremêlement des temps et des récits, de la poésie et du carnet scientifique, de la beauté et du tragique font de ce premier roman une lecture marquante, qui serait comme un redéploiement par la fiction des passionnants travaux anthropologiques de Nastassja Martin.
Disponible en format numérique ici
Là, dans l’amas de la rentrée littéraire, brille un petit bijou.
Les pierres de la cour d’une maison cévenole y prennent la parole. Témoins de la vie dans la demeure, elles racontent l’histoire d’une fratrie grandissant dans un hameau au milieu de la nature et des montagnes qui la surplombent, et qui compte en son sein un membre particulier: un petit aux yeux noirs qui flottent et s’échappent dans le vague, aux pieds recourbés et aux éclats de voix stridents, un éternel bébé toujours allongé, un petit lourdement handicapé. Les pierres racontent la place qu’il occupe dans ce clan à l’enfance bouleversée par sa présence. Elles racontent son frère aîné qui, d’emblée, dépourvu de toute insouciance et épris d’un amour exclusif, se sent investi d’un devoir de protection, s’attache fermement au petit, le couve, l’entoure, l’enserre jusqu’à s’oublier et se perdre. Elles racontent la sœur cadette, en qui s’enracinent dégoût, honte et colère envers le petit, répulsion mutique face à l’attention qu’il accapare jusqu’à la révolte coupable précédent la fuite du giron familial. Elles racontent enfin celui qui, partageant son quotidien solitaire avec les fantômes de la famille, incarne la renaissance.
Les pierres disent la naissance d’un enfant handicapé vécue par ses frères et sœurs.
Tant par la thématique qu’il traite que par le procédé narratif avec lequel il la traite, S’adapter est un conte de la réalité, un récit dont les tons clairs obscurs mènent délicatement le lecteur hors des sentiers battus. La douce mise au jour d’un vécu partagé par des familles d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Disponible en format numérique ici
Je suis dans la mémoire des choses.
Au commencement de tout.
Un vieil homme immobile sur une barque. Lac El-Assad, Syrie.
De temps en temps, silencieusement, il plonge. Respiration, masque, tuba. Il plonge pour retrouver son enfance, son passé. Sa ville engloutie sous les eaux, depuis la construction du barrage de Tabqa. Il plonge pour revivre ses 7 ans, humer le prunier de la maison d’autrefois, revoir le café Farah à deux pas de la mosquée…
C’est Mahmoud Elmachi, le poète, le vieux sage, le vieux fou. Le rescapé des geôles d’Hafez El-Assad, l’amoureux lumineux de Sarah, le père d’une fille et de deux garçons qui se battent aujourd’hui pour la liberté.
Ecoutez sa voix, ses mots; écoutez.
Antoine Wauters illumine la rentrée littéraire par ce roman poétique, politique, intime et bouleversant. Ecrit en vers libre, dans une langue d’une beauté incroyable, il donne voix à Mahmoud et sa femme Sarah. Et à travers eux, c’est 50 ans de l’histoire syrienne qui nous prend à la gorge. Une histoire de violence, de destruction, d’un régime de la terreur.
En écrivant des poèmes aussi doux (…) dans un pays aussi brutal, Mahmoud a fait partie des hommes et des femmes qui luttent et refusent de se soumettre. Mais que peut un poème dans un pays qui se meurt ? Dans l’épaisseur du monologue et des longs silences du vieil homme se cache entre autres une réflexion poignante sur l’écriture et la résistance.
C’est un livre audacieux, sensible et engagé. Un roman violent et doux à la fois.
C’est un long poème qui ne vous lâchera pas.
Disponible en format numérique ici