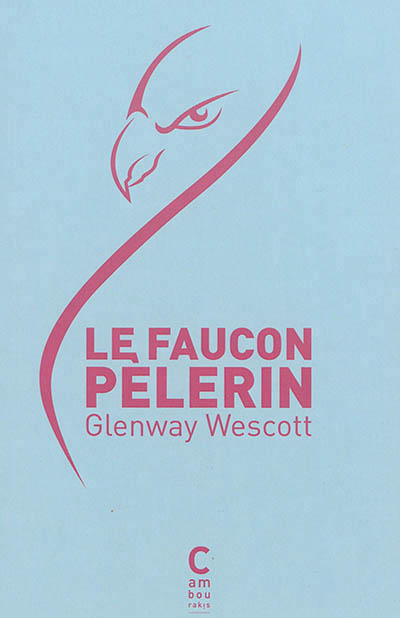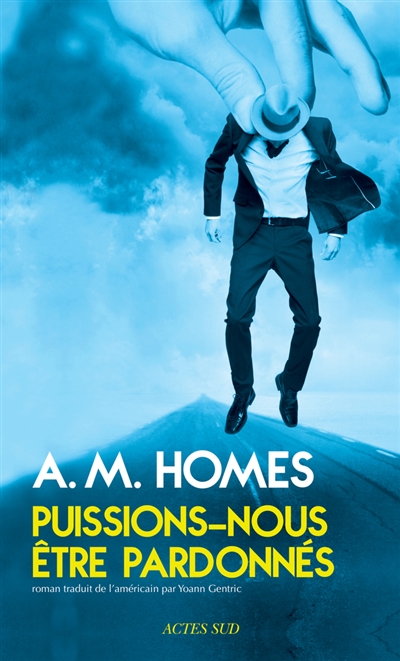Littérature étrangère
Été 1940. Alors que la France s'enfonce dans les années sombres de l'occupation, Alwyn Tower, écrivain américain, se souvient avec mélancolie d'un long séjour effectué douze ans plus tôt dans la campagne du Val de Loire.
1928. Alwyn retrouve une vieille amie, Alex, établie en France depuis quelques années. Une après-midi languissante, un couple vient en visite. Irlandais, les Cullen sont en route vers une villégiature en Hongrie. Ils ont connu Alex au Maroc quelques années auparavant, et sont heureux de lui rendre une visite de courtoisie. Mais les Cullen ne viennent pas seuls: sur le poignet de l'épouse trône Lucy, le faucon pèlerin qu'elle a acheté peu de temps auparavant pour assouvir sa passion de la chasse.
Isabel Cullen a été belle. Elle aime s'adonner à des passions aussi dévorantes que rapidement abandonnées (ses enfants devenus grands, la cause des nationalistes irlandais, les voyages au long cours). Lucy est sa nouvelle raison de vivre. L'oiseau ne la quitte pas. D'abord amusés et intrigués, Alex et Alwyn comprennent rapidement que le rapace fait planer une ombre menaçante sur le couple des Cullen. Malgré son apparente bonhomie, l'époux semble en effet ulcéré d'avoir dû céder la place. Soumis aux caprices de sa femme, il attend en se plongeant dans l'alcool de retrouver grâce aux yeux de celle-ci. Et la tension de monter, page après page...
On connaît peu Glenway Wescott. Éclipsé par la gloire de Fitzgerald ou Hemingway, cet autre "Américain de Paris" a pourtant écrit avec "Le faucon pèlerin" un chef-d'oeuvre de suspense, d'une brûlante intensité. Avec subtilité, il fait de Lucy le symbole de l'échec conjugal, de la liberté à jamais perdue, de l'amertume à laquelle sont voués les amants vieillissants. Le texte, qui commence sur un ton alerte et facétieux, avance par petites touches vers le registre de la tragédie. On ne sort pas indemne d'une lecture si malsaine, si dérangeante. C'est pourtant un ravissement de s'y plonger...
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Isabelle Chapman, Cambourakis, 10 €
"Faites vous-même votre malheur", proposait dans un livre célèbre le psychothérapeute américain Paul Watzlawick. Les personnages de A. M. Homes sont à n'en pas douter très doués en la matière.
Jugez plutôt: deux frères que tout semble opposer, un violent accident, un crime passionnel, un séjour en institut psychiatrique... Dès les premières pages de son roman, la romancière américaine accumule les atrocités et la violence, comme si le sort s'acharnait sur la famille Silver. George Silver, le plus jeune des deux frères, a toujours été colérique, violent et ingérable. Son tempérament hargneux l'a aidé à gravir les échelons et à devenir président d'une chaîne de télé-réalité. Plus sage, son aîné Harry mène une vie un peu terne. Professeur dans une faculté de second ordre, passionné compulsivement par le parcours de Richard Nixon, il a tôt appris à composer avec les sautes d'humeur de George. Quand la vie de la famille dérape, Harry doit endosser de nouvelles responsabilités: s'occuper de ses neveu et nièce adolescents, prendre sous son aile le petit orphelin dont son frère a décimé la famille, gérer son propre divorce et son renvoi de l'Université. C'est beaucoup pour la frèle carrure de ce perdant magnifique...
"Puissions-nous être pardonnés" est une fresque au souffle puissant, un roman sur la vanité, la chute et la rédemption. Et malgré la gravité et la noirceur du propos, "Puissions-nous être pardonnés" est aussi un livre très drôle, une comédie avec des scènes d'une cocasserie et d'un burlesque invraisemblables. A. M. Homes dézingue à tout va un certain rêve américain. La farce va loin, parfois à la limite du supportable, mais sans jamais tomber dans le voyeurisme ou la vulgarité. On pense au "Bûcher des vanités" de Tom Wolfe, parfois aussi aux "Corrections" de Jonathan Franzen (Harry fait immanquablement penser, en pire, à Chip Lambert): A. M. Homes s'inscrit à n'en pas douter dans la meilleure tradition de la littérature américaine. Depuis "Ce livre va vous sauver la vie", elle trace un joli parcours d'écrivaine, profondément dérangeant et original.
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Yoann Gentrick, Actes Sud, 24 €
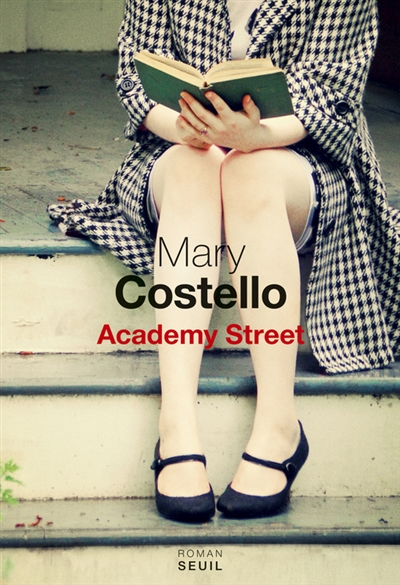 L'avis d'Anouk:
L'avis d'Anouk:
C'est un roman à la fois modeste et brillant. Modeste par son apparente simplicité, par son héroïne surtout, cette Tess Lohan qui mène une vie sans éclat, sans passion, sans beaucoup de joie. Brillant par l'habileté romanesque de Mary Costello, qui réussit dès les premières pages de "Academy Street" (bouleversantes) à happer son lecteur et à insuffler la beauté dans ce destin de femme.
Dans l'Irlande rurale des années 40, une jeune mère meurt de la tuberculose. Tess, la plus jeune de ses six enfants, a sept ans à peine. On ne lui explique rien, les enfants ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Tess reste donc seule avec cette peine privée de mots. Cette expérience d'arrachement et de profonde solitude déterminera toute une vie, mise dès l'enfance comme en retrait du monde.
Tess grandit, gagne Dublin, prend son envol et son indépendance en rejoignant sa sœur aînée aux Etats-Unis. Devenue infirmière dans un hôpital new-yorkais, elle tombe amoureuse, a un fils qu'elle élèvera seule, une voisine qui lui prouve qu'il n'est pas si compliqué d'être heureux, une existence sans grand relief. L'humilité de Tess, sa résignation apparente à accepter la solitude, les deuils successifs, la monotonie du quotidien pourraient faire d'elle un personnage terne. C'est tout le contraire: le talent de Mary Costello à peindre l'intériorité de cette femme blessée, ses émotions les plus subtiles, les infimes sursauts de son âme, font de Tess une héroïne inoubliable, quelque part entre la Félicité d'Un coeur simple de Flaubert ou la Marie-Louise de En lisant Tourgueniev de William Trevor.
Un premier roman d'une infinie délicatesse, couronné en Irlande de prix prestigieux et salué notamment par J. M. Coetzee.
Traduit de l'anglais (Irlande) par Madeleine Nasalik, Le Seuil, 18.50 €
Existe aussi en format numérique : cliquez ici pour rejoindre Librel