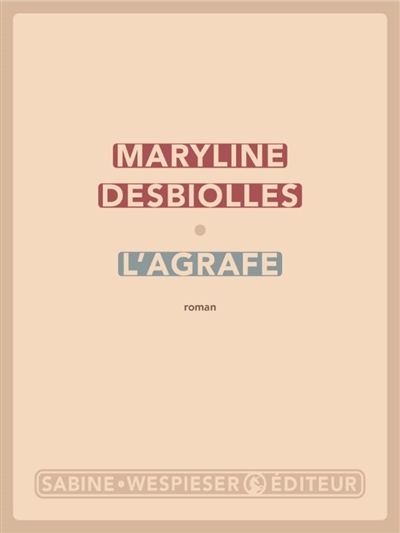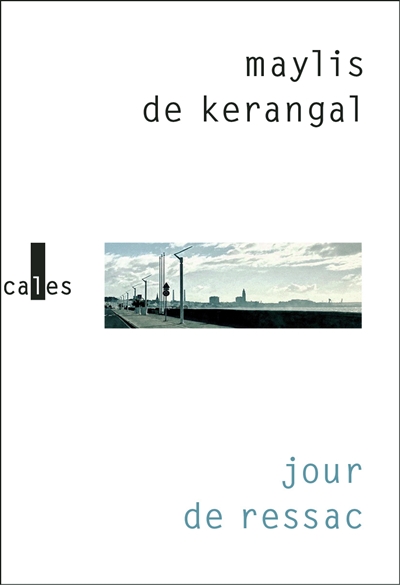Elle s'appelle Emma Fulconis.
Un nom rapide comme la foudre. Un nom qui convoque tout un paysage – la Méditerranée, ses arrière-pays rocailleux, une terre à cheval entre la France et l'Italie. Elle s'appelle Emma Fulconis et ce nom-là, vous ne l'oublierez pas.
Quand s'ouvre L'agrafe, l'étincelant roman que publie en cette rentrée Maryline Desbiolles, Emma court dans les collines sèches et abruptes qui enserrent son village. Emma est une fille qui court, c'est entendu: toujours en mouvement, silhouette vive et ardente. Pourtant, si on la regarde bien, elle ne court plus comme avant. Sa démarche est gauche, saccadée; elle s'accorde, "ainsi boiteuse, à ce territoire heurté". L'histoire de cette course effrénée et empêchée, c'est celle de L'agrafe, et elle est terrible.
Adolescente sauvage et solitaire, Emma Fulconis est insaisissable. Si elle court sans relâche, ce n'est pas pour la compétition mais pour faire corps avec le monde autour d'elle. "Elle ne courait pas relativement, mais absolument". Et puis un jour tout s'arrête. Invitée chez un ami, elle est attaquée par le chien de la maison qui déchiquète sa jambe gauche. De cette scène d'horreur et de douleur absolues, Emma garde un souvenir confus. Seuls demeurent, dans leur netteté plus tranchante encore que les dents du molosse, les mots prononcés par le père de son ami: "Mon chien n'aime pas les Arabes".
Le chemin qui s'ouvre ce jour-là pour Emma Fulconis est autrement escarpé que ces collines qu'elle arpente depuis l'enfance. Lente et douloureuse, la reconstruction de sa jambe massacrée s'accompagne de la quête de "ce qui la concerne de près et lui est étranger", l'histoire de sa famille maternelle. Une histoire écorchée et à vif, comme la jambe d'Emma, celle d'une famille algérienne arrivée en France parmi les convois de harkis.
Avec pudeur et justesse, Maryline Desbiolles transcende l'histoire d'Emma, cette histoire poignante de la haine ordinaire, en un hymne à la vie, à la passion, à la résistance. Emma pour qui "se tenir debout ne va plus de soi, se tenir debout est une souffrance", porte en elle la détermination d'avancer, de courir encore, de mettre des mots même boiteux sur son histoire. C'est bouleversant et magnifique.
Disponible en format numérique ici
En cette rentrée paraît en format de poche le précédent roman de Maryline Desbiolles, Il n'y aura pas de sang versé.
Blaise connaît mon penchant pour les histoires. Celles que je me raconte, celles que je raconte aux autres, celles où je me démultiplie, où je peux me cacher, redevenir une inconnue, en finir avec moi. Les histoires, c’est ta tendance, c’est ta gravitation interne, c’est ce qu’il me chuchote à l’oreille.
Tout est affaire de gravitation dans Jour de ressac – celle qui met en tension les morts et les vivants, une femme et la ville où elle a grandi, des corps amoureux, une mère et sa fille, hier et aujourd’hui. La gravitation aussi qui guide les marées, nourrit les vagues et leur ressac. Ce mouvement d’attraction qui fait tenir ensemble le proche et le lointain est au cœur du travail romanesque de Maylis de Kerangal. Chez elle, de livre en livre, l’intime s’inscrit dans un ordre plus vaste, les pulsations et émotions des personnages résonnent dans un paysage ouvert. En cela, Jour de ressac approfondit une œuvre à la puissante cohérence.
Il y ouvre aussi de nouveaux chemins. Ainsi, alors que l’on a souvent souligné combien les romans de Maylis de Kerangal explorent le geste et la façon dont les personnages façonnent le réel – la construction dans Naissance d’un pont, les technologies de pointe de la médecine dans Réparer les vivants, le geste artistique dans Un monde à portée de main – c’est plutôt de la voix dont il est question ici. La voix a une portée fragile, ténue ; elle ne façonne rien pas mais module l’espace et dit la vérité d’un être. Cette quête de la voix, qui était déjà au centre des nouvelles de Canoës, prend ici d’autant plus de sens que la narratrice, dont nous ne connaîtrons pas le nom, est doubleuse pour le cinéma et prête sa voix aux corps des autres, cherchant « à toucher parfois le flux intérieur » de l’actrice qu’elle fait parler. Métier de l’ombre, il sied bien à cette femme solitaire, forte et fragile, qui dit d’elle-même « je renonce très vite à l’exactitude mais pas à la justesse ».
C’est aussi une voix qui met en mouvement le roman, celle de l’officier de police qui cueille la narratrice chez elle, un jour de novembre, pour la convoquer au Havre en urgence. On a retrouvé la veille sur une plage le corps sans vie d’un homme. Tout porte à croire à un homicide et le seul indice permettant l’identification de la victime est un ticket de cinéma retrouvé dans sa poche. Au dos de ce ticket figure le numéro de téléphone de la narratrice. Prise dans une affaire qui fait éclater le décor rassurant de son quotidien, elle gagne Le Havre, se prend au jeu de l’enquête, échafaude des hypothèses – « tout se passait comme si la lubie de l’enquête s’était emparée de moi ». Autour de ce corps sans identité tout devient incertain, le réel tremble, le passé s’invite.
C’est que Le Havre, pour la narratrice, est le territoire de l’enfance et de l’adolescence, la ville « tapie dans un arrière-monde tel un palais dans le brouillard ». En arpentant ses rues, elle traverse le temps, remonte les pistes et se laisser dérouter. L’errance qui suit son audition au commissariat avive les souvenirs de sa jeunesse, dans une ville où les blessures infligées par la guerre ont à peine eu le temps de cicatriser. Le Havre a été cette « ville par terre », martyrisée sous les bombes ; son visage, comme celui de l’homme mort sur la plage, était alors impossible à reconnaître. Puis la ville s’est relevée, construisant sur les ruines un nouveau décor. Damier de bêton, lignes de fuite, couloirs où le vent frappe et tout ce réseau serré de passages, de tunnels, cette « contre-carte du territoire » où circulent les corps et les histoires. Le Havre est un terrain toujours incertain, où le réel se double d’échappées imaginaires, sublime décor pour les vacillements de la narratrice.
Le Havre, que Maylis de Kerangal connaît bien puisqu'elle aussi y a grandi, tend à son travail d'écriture un passionnant miroir, alternant les échappées vers le large et la traversée d’un tissu urbain dense où attraper le réel dans ses plus infimes variations. Comme toujours, la langue de Maylis de Kerangal saisit par sa beauté singulière et sa virtuosité. Telle la vague et son ressac, elle oscille entre accélérations fulgurantes et moments où elle se dépose, scintillant dans la lumière normande.
De ce roman si dense et habité, il y aurait bien des tableaux à déployer encore. Comment, par exemple, la jeunesse y palpite – celle de la narratrice, ressurgie à la faveur de son échappée havraise, celle de sa fille Maïa, vingt ans, la fougue souveraine. Comment, avec autant d'intensité que dans Réparer les vivants, il est question de réintégrer un corps mort parmi les corps des vivants. Comment Jour de ressac s'aventure dans un paysage woolfien, avec sa promenade au phare, avec le clin d'oeil de soeurs prénommées Vanessa et Virginia, avec sa façon de faire miroiter tous les flux de pensée d'une femme saisie dans un moment d'incertitude. Comment Maylis de Kerangal fait place aux questions brûlantes d'aujourd'hui, la guerre ukrainienne, le désespoir de l'exil, les narcotrafics. Tant de registres et d'histoires qui s'emboîtent avec souplesse et fluidité et soulignent le talent et l'audace de Maylis de Kerangal.
Jour de ressac est bien un livre de notre temps inquiet et incertain. Si le roman nous submerge à ce point d’émotion, c’est dans sa capacité à donner corps aux vacillements, à ces secousses infimes qui viennent désajuster le cours de nos vies et nous invitent, toujours, comme la vague qui revient, à nous réinventer.
Maylis de Kerangal présentera Jour de ressac à la librairie le mardi 24 septembre à 19h30. Toutes les infos sont ici.
L’action se déroule en 1953 dans les quartiers populaires de Toulon. La ville est encore meurtrie par la Seconde Guerre mondiale, alors que la Guerre d’Algérie s’apprête à éclater au-delà de la Méditerranée. Rose est une mère de famille d’âge mûr, femme d’ouvrier. D’origine corse, son mari et elle ont définitivement quitté leur île des années auparavant avec un maigre balluchon et leurs trois enfants sous les bras afin de se faire une meilleure vie sur le continent. Toulon et ses grands chantiers les ont incorporés…
Un matin, au coin d’une rue, Rose fait la connaissance de Farida, qui vient d’arriver d’Algérie et vit depuis peu au bidonville de Toulon. Une amitié va peu à peu se nouer entre les deux femmes, dont les générations et les parcours diffèrent et qui pourtant, par cette rencontre, vont prendre conscience de leur condition et changer le cours de leur existence. Par le biais d’une relation qui se tisse entre deux personnages marginalisés, l’écrivain Christian Astolfi aborde de grandes questions du temps : la condition féminine, l’immigration, l’intégration, l’émancipation sociale, la guerre.
Voici un texte intense et délicat à la fois, un roman social engagé, qui décrypte subtilement le ressenti humain et le tremplin vital qu’est la relation à l’autre. Un très beau livre.
Le Bruit du Monde, 21 euros.