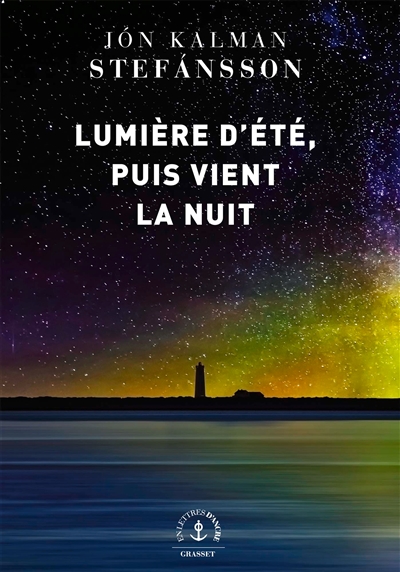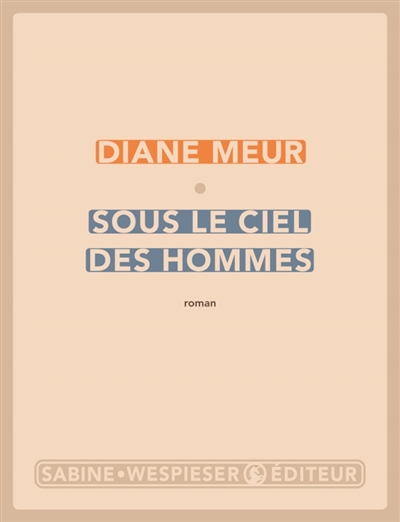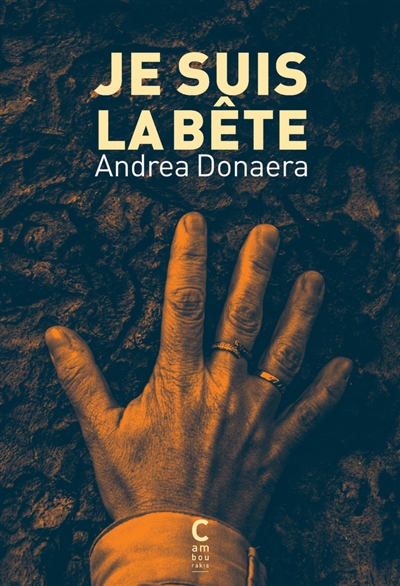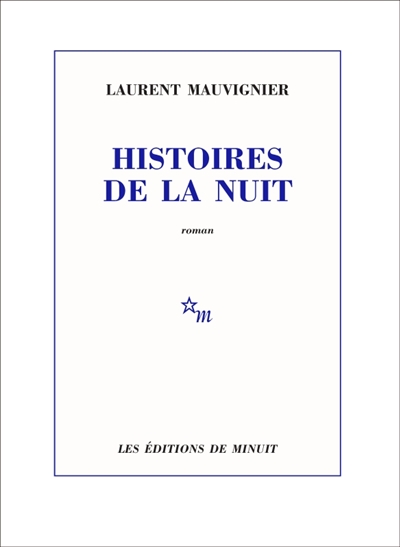Nos lectures
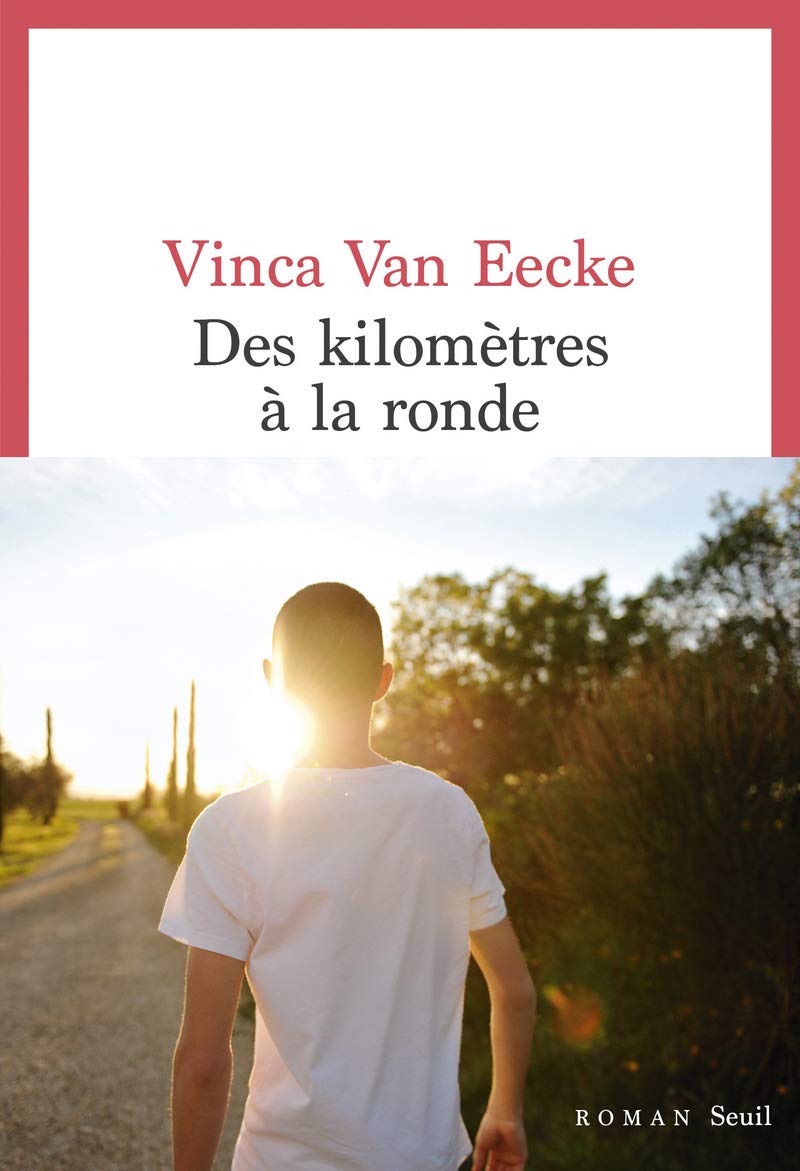 L'avis d'Adrien :
L'avis d'Adrien :
Durant son adolescence, une citadine passe tous ses étés dans une petite bourgade campagnarde du Morvan. Là, elle retrouve une bande de jeunes gars en gentil décrochage, aimant les bêtises et tuant leur ennui en les enchaînant. On sent bien le drame survenir, il surviendra, mais aussi toute la tendresse, la curiosité, l’intérêt et l’admiration mêlés face à cette bande de charmants renégats.
En exergue de ce premier roman, une phrase de « Sur la route » et c’est bien de cela qu’il s’agit de jeunes chevaux fous qui ici malheureusement ne prendront pas la route. Ajoutons qu’avec cette héroïne, narratrice d’aujourd’hui de ces événements d’hier, et la couleur particulièrement mélancolique du passé imparfait, c’est à une autre référence américaine qu’on pense, « Virgin Suicides ». Le drame humain n’ira pas jusqu’à l’extrémité des cinq sœurs Lisbon engluées dans un carcan trop étroit pour elles mais le drame social de cette France qu’on oublie est bien là.
Notre appréhension de se retrouver face à un nouvel "Eté des charognes" ou "Leurs enfants après eux" est vite tue par le style de Vinca Van Eecke et l’angle adopté par cette dernière. L’autrice nous livre un beau portrait doux amer de la jeunesse de la France périphérique, un « Péril jeune » dans les campagnes du Morvan.
Seuil, 18 €
Disponible en version numérique par ici.
Qu'est-ce qu'un roman réussi? Celui qui, racontant une expérience lointaine et singulière, parle intimement à chacun de ses lecteurs. En ce sens, Lumière d'été, puis vient la nuit, comme tous les livres de Jón Kalman Stefánsson, est une réussite éclatante. En déroulant le fil des histoires d'un village isolé sur la pointe Ouest de l'Islande, il nous donne des nouvelles de nos désirs, de nos fantômes, de nos espoirs. Il éclaire, remue, étonne avec grâce et légèreté.
La magie des livres de Jón Kalman Stefánsson vient de leur langue, une langue limpide mais qui mobilise tous les registres et mêle le lyrique au trivial, le souffle épique aux vies minuscules. C'est que, pour affronter l'opaque nuit islandaise, il faut s'armer de mots et garder à l'esprit que "la plupart des mots ont tant de facettes que nous sommes souvent pris de vertiges". Avec ces mots, avec le sédiment qu'ils déposent, on assemble des histoires qui ont quelque chose d'organique, qui tiennent en vie aussi fermement que l'air qu'on respire, des histoires qui sont le meilleur remède à la solitude et au chagrin.
Dans le village dont nous parle Lumière d'été..., il n'y a ni église, ni cimetière. L'éternité choisit de s'y manifester dans le ciel si vaste. Un ciel que scrute inlassablement l'ancien directeur de l'usine locale devenu astronome après avoir, une nuit, fait un rêve en latin. Cette histoire ouvre le livre, elle sera bientôt tissée à des dizaines d'autres, drôles ou poignantes, couvrant d'un manteau narratif ce village dont "la particularité (...) consistait précisément à n'en avoir aucune". Tout l'art de Stefánsson tient là, dans la couture souple de ces bouts de vie. L'époque n'est plus aux sagas qui ont donné son âme à l'Islande, ni aux destins dépliés d'un point à un autre, linéairement. Aujourd'hui, les vies sont complexes, pleines de hasards et de ruptures; elles cachent sous les apparences des mondes insoupçonnés: un grand désordre d'inconscient, de rêves enfuis, d'occasions que l'on n'a pas tentées. "On ne parvient jamais à tout raconter, on ne fait que rassembler des fragments, mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous en contenter". C'est ce matériau-là, fragmentaire et mouvant, que travaille le romancier. Comme l'astronome, comme son fils qui observe en silence les oiseaux sur la lande, il sait "qu'il faut également prendre soin des choses invisibles".
Lumière d'été, puis vient la nuit est un roman dont le charme se diffuse généreusement. Moins âpre que les autres livres de son auteur, il n'en est pas moins ensorcelant. Sous les apparences d'une chronique villageoise, Jón Kalman Stefánsson éclaire la beauté et le tragique de toute vie humaine: "la vie semble parfois d'autant plus vaste que le lieu qui l'abrite est petit".
Grasset, traduit de l'islandais par Éric Boury, 23.50 euros
Disponible en format numérique ici
Quel plaisir de retrouver, cinq ans après l'étourdissante «Carte des Mendelsohn», l'intelligence pétillante et la finesse de Diane Meur !
On connaît le tropisme de la romancière pour la Mitteleuropa, où elle pose le cadre de la plupart de ses romans. C'est cette fois une Mitteleuropa d'opérette qu'elle déploie, facétieux décor de montagnes et de lacs dont la prospérité cache mal les failles: bienvenue au Grand-Duché d'Éponne. En plein cœur de l'Europe, ce micro-état ne s'arrache à sa torpeur qu'au rythme des transactions financières qui s'y jouent. Siège de nombreuses institutions bancaires internationales, Éponne a pour autant conservé ses habitudes placides, et «rien ne se transforme qu'à contrecoeur» sous son ciel trop lisse.
C'est là que Diane Meur installe sa comédie humaine, un théâtre joyeux et débridé où se tissent les destins de personnages hauts en couleurs. Prenez Féron: journaliste à succès, il a parcouru le monde et aspire désormais à une vie paisible. Pour soigner sa notoriété, il songe à écrire un roman. Et si l'inspiration lui manque, son éditeur a trouvé la parade: il suffit à Féron d'accueillir chez lui, pour quelques semaines, un candidat réfugié et de raconter leur vie commune – émotion et gros tirages assurés! Heureusement, le cynisme de Féron n'a pas gagné tout le monde à Éponne. Il reste quelques irréductibles qui veulent croire que l'utopie a de l'avenir et se rassemblent chaque semaine pour écrire collectivement un texte d'intervention censé secouer durablement le paysage politique du Grand-Duché.
Le roman de Féron, le pamphlet anticapitaliste: ces deux livres qui s'écrivent en parallèle tissent la trame de celui de Diane Meur. Le procédé pourrait être fastidieux mais s'avère sous sa plume alerte une géniale machination romanesque. Car bien entendu les choses vont dévier, les trajectoires sortir des chemins attendus, et dans ce débordement il faudra bien que chacun s'interroge sur ce qu'il fait de sa liberté: «N'est-on pas né pour, un beau jour, choisir son temps et ce qu'on veut en faire? Et si ce n'est pas maintenant, alors, quand?».
Sous ses allures de conte malicieux, «Sous le ciel des hommes» déplie toutes les grandes questions d'aujourd'hui: les dominations et les assignations, la paresse intellectuelle, la nécessité du mélange et de l'altérité, l'utopie à reconquérir et les révoltes à inventer. Subtil, toujours en mouvement à l'image de ses nombreux protagonistes, le roman invite à faire le pari d'un monde meilleur. On en a bien besoin...
Sabine Wespieser, 22 euros
Disponible en format numérique ici
Et Mimì pense qu'il va les tuer tous. Tous, s'ils ne partent pas, s'ils ne partent pas d'ici, s'ils ne le laissent pas seul, dans ce salon, Mimì va faire un carnage, il va les tuer tous.
C'est ainsi que s'ouvre "Je suis la bête", le magistral premier roman d'Andrea Donaera, et dès ces premières lignes tout est déjà là: la tension, la noirceur, la dimension implacable de la spirale de violence qui s'enclenche. La puissance de l'écriture aussi, ces mots âpres qui tournent et reviennent et piétinent autour des mêmes obsessions jusqu'à faire exploser les sens.
Dans le salon où Domenico Trevi, dit Mimì, laisse enfler sa fureur, il y a un cercueil, et dans ce cercueil le corps méconnaissable de son fils. Le garçon s'est suicidé en se jetant de la fenêtre de l'appartement familial. Il avait quinze ans, une âme de poète emprisonnée dans 130 kilos de chair, un chagrin d'amour trop lourd à porter.
"Je suis la bête" est une plongée au coeur des Pouilles, terre délaissée des lettres italiennes. Loin du cliché touristique, ce qu'Andrea Donaera fait éprouver, c'est le sirocco, la moiteur suffocante, l'emprise du patriarcat et de la "Société", cette Sacra Corona Unità dont Mimì est l'un des barons, puissant et craint. Épaulé par des sbires dont l'obéissance servile n'a d'égale que la cruauté, Mimì met en place un engrenage de vengeance pour punir Nicole, la plus belle fille du lycée, celle qui a éconduit son fils et, il en est persuadé, l'a mené au suicide.
On avance vers la tragédie en alternant les points de vue. De chapitre en chapitre, d'autres voix répondent à celle de Mimì – sa fille Arianna, Nicole elle-même et Veli, tout à la fois séquestré par le clan et geôlier d'autres victimes. Chacune de ces voix s'épuise dans le même ressassement, comme s'il fallait éprouver les mots, les cogner sans cesse contre les angles de la réalité pour creuser un chemin de compréhension dans le tumulte des sentiments. Ce travail sur la langue donne au livre son goût minéral et sa puissance peu commune.
Envoûtant, obsédant, jamais complaisant dans sa peinture de la violence, "Je suis la bête" est un roman qui capte au plus juste l'âme d'une terre et des hommes qui l'habitent. Un livre stupéfiant de maîtrise, qui émeut et ébranle à chaque page.
Cambourakis, traduit de l'italien par Lise Caillat, 21 euros
Un titre de livre pour enfants, une trame de thriller, un décor enraciné dans la campagne française: avec "Histoires de la nuit", Laurent Mauvignier emprunte un singulier chemin et pousse l'art du roman dans ses retranchements. Une audace folle et une éclatante réussite: "Histoires de la nuit" vous attrape comme peu de livres arrivent à le faire.
Quelques maisons perdues, que l'on entrevoit depuis une nationale «pour peu qu'on décide d'y prêter attention»: c'est le hameau des trois filles seules. Deux maisons seulement sont habitées, par Bergogne, agriculteur endetté, taciturne mais amoureux, et par Christine, une artiste qui a quitté Paris pour s'installer loin des bruits du monde. Il y a entre ces improbables voisins un tissu dense de complicité, d'attentions, de routines. Quand s'ouvre le livre, on s'apprête à ouvrir une brèche dans la vie ordinaire: ce soir-là, on fêtera les 40 ans de Marion, l'épouse de Bergogne. Ce soir-là ne sera pas comme les autres.
Le roman court le temps de quelques heures, entre la fin d'après-midi et la nuit. Laurent Mauvignier réussit avec une maîtrise confondante la fusion de la tension extrême et de la lenteur. Pour étirer ou accélérer le temps, il s'appuie sur une mécanique implacable de polar et creuse dans les schémas attendus des interstices où se déploie son écriture souple, précise, qui fouille au plus profond les recoins de l'âme.
On s'en voudrait d'en dire trop sur une intrigue haletante, qui se relance sans cesse et capture jusqu'à la fin l'attention et l'émotion du lecteur. Disons qu'il s'agit d'une histoire de vengeance, d'un huis-clos qui s'origine loin, dans les blessures mal cicatrisées des protagonistes. Laurent Mauvignier, comme dans tous ses romans depuis "Loin d'eux", fait parler avec justesse les voix intérieures. Il offre dignité et complexité à chaque personnage, jamais figé dans ce que l'on a cru percevoir de lui. Comme Christine face à ses toiles, les phrases reviennent sur leurs pas, font le tour de ce qu'elles cherchent à cerner, reprennent les motifs «pour qu'une forme qui soit pleine, irréversible, apparaisse».
"Histoires de la nuit" est un suspense addictif mais aussi une fresque sociale, une peinture fine de notre société, de ce que c'est que faire couple, faire famille, faire communauté aujourd'hui. Comme souvent, Laurent Mauvignier dépeint la vie de femmes et d'hommes qui peinent à se donner des horizons, coincés dans des vies trop étroites et dans des places assignées. Parfois ils pensent que la chance tourne, comme Bergogne qui rencontre Marion, fonde une famille et échappe à son destin solitaire. Parfois ils ont la volonté d'écrire de nouvelles pages et de recommencer, ailleurs, mieux, une vie qui ne leur convenait plus, comme Marion ou Christine. Mais pour qu'un destin s'infléchisse, il y a un prix à payer. Et c'est implacable.
C'est plutôt du côté des grands Américains, de Faulkner à Joyce Carol Oates, que l'on pourrait trouver des échos à ces "Histoires de la nuit". Pour la capacité à susciter la tension et à la maintenir de bout en bout, tout en conservant intacte l'exigence d'une écriture et d'une réflexion sur celle-ci. Pour la puissance de l'architecture narrative. Pour la mise à nu de l'expérience humaine dans ce qu'elle a de plus ordinaire et de plus extrême. Comme l'écrit David Forster Wallace, cité en exergue : « Il y a pourtant des secrets à l'intérieur des secrets – toujours ».
Disponible en format numérique ici