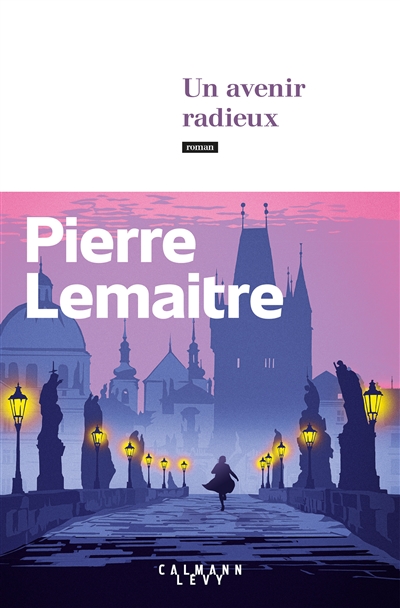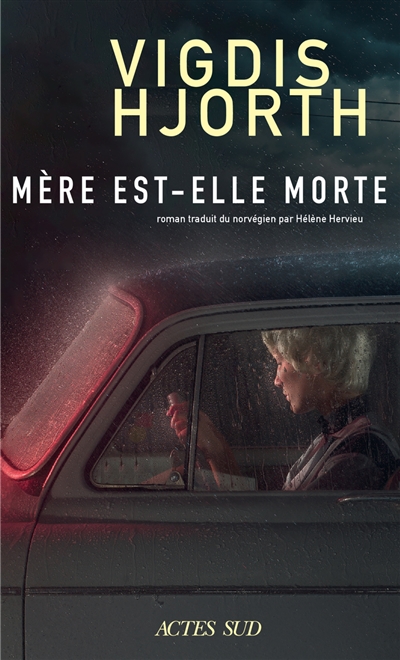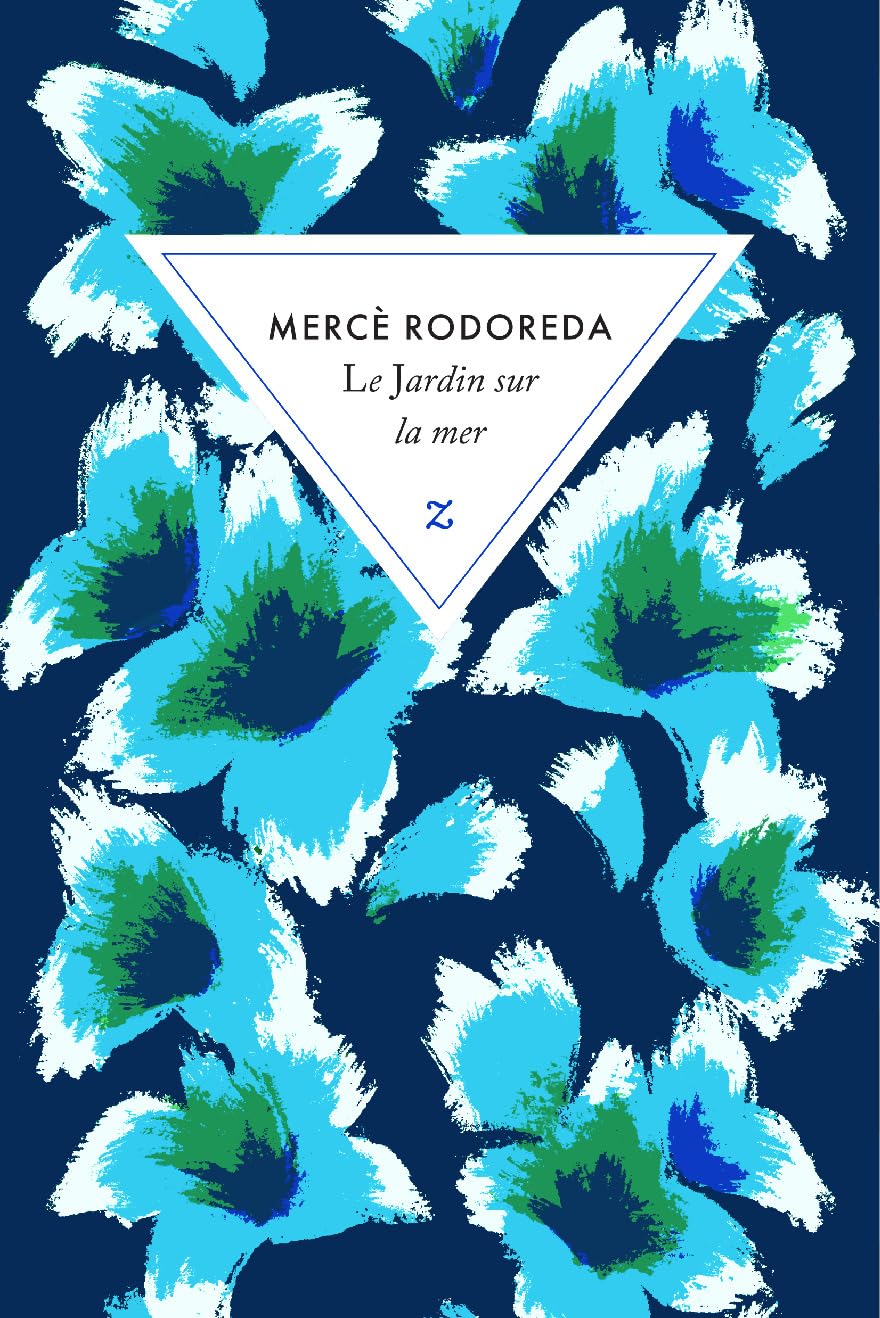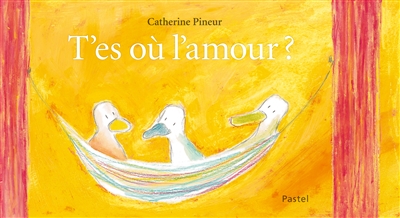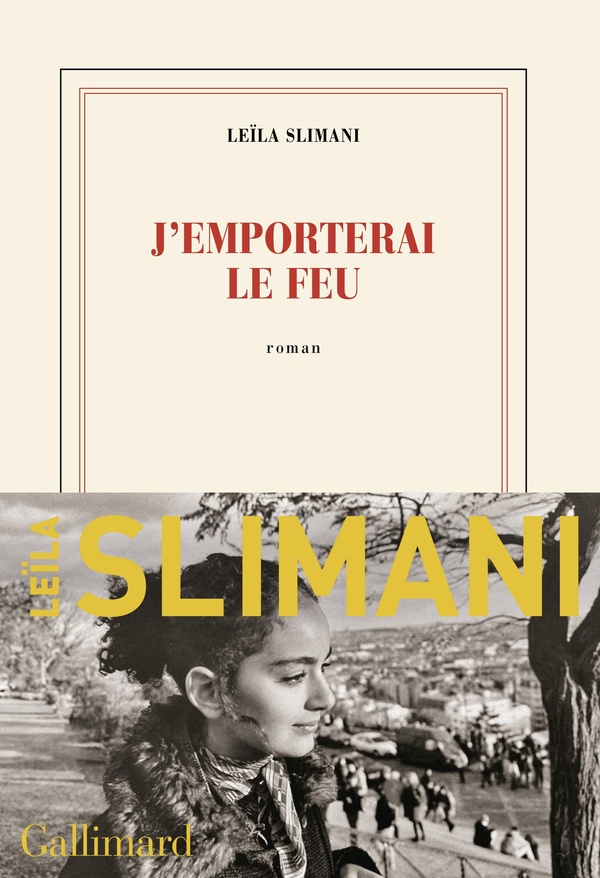Nos lectures
Les Trente Glorieuses : période faste et dite « de progrès » durant laquelle, selon Pierre Lemaître (né en 1951), a doucement mais sûrement germé notre infortune contemporaine… Dans ce tant attendu troisième volet des Années glorieuses, le lecteur poursuit les tribulations des membres de la famille Pelletier entre Paris et Prague, cette fois, en plein boom économique et au cœur de la tourmente de la Guerre froide.
Nous sommes en 1959. L’un des fils Pelletier, chef d’une chaîne de magasins implantée dans toute la France, est invité à se rendre à Prague pour une visite officielle censée sceller un pacte commercial entre l’Hexagone et la Tchécoslovaquie. Jean Pelletier ignore alors que c’est en réalité son frère François, journaliste de profession, qui va se retrouver pris au piège de cette capitale communiste infestée de délateurs et de miliciens tortionnaires. Cela tandis qu’à l’Ouest, en dépit de l’absence glaçante d’un des leurs, la jeune Colette, sa perfide mère Geneviève, ainsi que ses tantes Hélène et Nine composent tant bien que mal leurs parcours sinueux, dans ces temps de croissance prometteurs d’un avenir radieux pour tous, mais où les inégalités embrasent bel et bien chacune des strates de la société.
À travers le dernier pan de sa saga historique et familiale, aux teintes de roman d’aventure et d’espionnage, Pierre Lemaître renoue formidablement avec la tradition des feuilletonnistes du XIXe siècle. Et c’est bien là son projet romanesque : concevoir de la littérature populaire de belle facture, dans laquelle chaque lecteur se verra d’emblée emporté. De fait, les caractères des personnages sont hauts en couleurs, les rebondissements de l’intrigue multiples et, comme de coutume chez l’écrivain, le ton narratif savoureusement relevé.
Voilà une fresque de 585 pages (seulement…) à dévorer goulument !
Calmann Levy, 23,90 euros.
Il y a longtemps que Johanna est partie.
Trente ans se sont écoulés depuis qu’elle a quitté mari, famille, pays natal pour suivre un homme follement aimé et pour devenir l’artiste qu’elle n’aurait pu être sans rompre des amarres trop lourdes. Johanna a fait sa vie aux États-Unis. Elle est désormais une artiste reconnue. Sa peinture, qui questionne la famille et la figure maternelle, est à la fois enracinée dans son histoire intime et profondément universelle.
Pendant ces trente années, Johanna n’est jamais retournée en Norvège. Ses relations avec ses parents et sa sœur se sont lentement étiolées, puis définitivement brisées lorsqu’elle a choisi de ne pas rentrer à la mort du père. Le temps a beau passer, il n’efface pas le poids du chagrin et du déchirement. Aussi, lorsqu’elle est invitée en Norvège pour une rétrospective de son œuvre, Johanna sait qu’elle va aussi tenter de recoller les éclats tranchants de son histoire familiale.
À près de soixante ans, Johanna a encore du mal à se définir autrement que fille ou sœur, « parce que nous sommes des entités mythologiques les unes pour les autres, et parce que nous sommes ennemies, qui n’est pas curieux de son ennemi ». Un soir, elle tente d’appeler sa mère. Celle-ci ne décroche pas. Commence alors une traque épousant de plus en plus les contours de l’obsession: Johanna en planque devant l’immeuble de sa mère; Johanna suivant les dames âgées dans la rue; Johanna espionnant sa mère et sa sœur en visite sur la tombe du père; Johanna traquant le flux des souvenirs imprécis qui remontent depuis l’enfance.
Partant de ce matériau fragile, Johanna invente les vies possibles de cette mère qui l’a bannie. « Que des enfants renient leurs parents est compréhensible, que des parents renient leurs enfants, et de manière si intraitable, est rare ». À tâtons, Johanna s’interroge sur ce qu’il reste en elle de son enfance, sur la manière dont l’art l’aide à « arracher le bandeau de [ses] yeux ». Son monologue s’écrit en chapitres brefs, crus, haletants. Le blanc de la page souligne la solitude insondable de cette femme blessée.
Devant l’atelier qu’elle a installé en forêt le temps de son séjour norvégien, Johanna croise souvent un élan. Bête massive, primitive, qui prend l’habitude de s’installer face à elle et semble voir en elle des choses qu’elle-même a du mal à discerner. Un jour l’élan si paisible est devenu comme fou. Il court à perdre haleine, fracasse sa tête contre les arbres, arrache violemment sa ramure trop lourde: « Cela ressemblait à de l’automutilation et à de l’autodestruction frustrées ou à une protestation contres les conditions de vie sur terre ». Puis les derniers bois tombent et l’élan retrouve son calme, libéré. C’est ce même travail qui attend Johanna: malgré la douleur, s’extraire d’une ramure qui l’enferme depuis trop longtemps.
De cette intrigue ténue – une mère, une fille, la pelote inextricable de leurs relations – Vigdis Hjorth tire un roman fascinant et captivant, douloureux mais aussi empreint d’ironie, voire d'une forme de fantaisie décalée. Mère est-elle morte est une exploration d’une grande perspicacité de l’âme humaine et de ses tourments.
Actes Sud, traduit du norvégien par Hélène Hervieu, 23.50 euros
Mercè Rodoreda est l’une des grandes voix de la littérature catalane. L’arrivée du franquisme l’a contrainte à l’exil mais elle n’a cessé de raconter dans son œuvre la terre de sa jeunesse et les gens qui l’habitent.
L’éloignement teinte d’une lumière particulière ce Jardin sur la mer, roman subtil de l’amour et de la perte.
Le narrateur est jardinier. Il entretient depuis des années le jardin d’une villa cossue, résidence d’été de riches Barcelonais. La maison vient de changer de propriétaires, c’est un jeune couple désormais qui y passe ses étés en joyeuse compagnie. Mais si les maîtres changent, le jardinier demeure, ancré à cette terre dont il connaît tous les secrets et sait entendre les chuchotements. Au milieu des fleurs dont il prend soin, le jardinier observe. Rien n’échappe à son attention bienveillante, qui fait de lui le confident idéal des uns et des autres.
Puis un été tout bascule. La visite d’un couple âgé, porteur d’un douloureux secret, et l’installation de nouveaux voisins déchirent le voile des habitudes. Les fantômes surgissent et le drame semble inéluctable.
Mercè Rodoreda peint avec finesse ce théâtre où végétal et humain se reflètent et se répondent. Le monologue du jardinier, tout d’ironie et de sensibilité, va droit à l’essentiel. "Regardez le jardin, regardez comme il est. Pour en sentir la force et le parfum, c’est la meilleure heure. Regardez les tilleuls... Vous voyez comme les feuilles tremblent et nous écoutent ? Vous riez... Si un jour vous vous promenez la nuit sous les arbres, vous verrez tout ce qu’il vous racontera, ce jardin..."
Éditions Zulma, traduit du catalan par Edmond Raillard, 21.50 euros
Disponible en format numérique ici
Aujourd'hui, Joséphine a décidé qu'il fallait parler d'amour. Ses copains Suzie et Barnabé sont d'accord mais ne savent pas trop comment s'y prendre. Alors Joséphine, très sérieuse, s'assied comme un bouddha et laisse parler son coeur. C'est très doux, dans le coeur de Joséphine: il y a tout l'amour de sa maman, un amour qui dure pour toujours.
Vient le tour de Barnabé, puis de Suzie... C'est rigolo de parler d'amour avec eux. Bon d'accord, ils ne sont pas aussi appliqués que Joséphine le réclame, mais ils ne manquent pas d'idées et d'espièglerie pour parler de l'amour et des fleurs, du goût des brocolis et de ce bébé qui arrivera bientôt chez Suzie, et dont elle sait déjà qu'elle l'aimera "certainement pour toujours, mais peut-être pas tout le temps".
On retrouve avec délice Joséphine, Suzie et Barnabé, les oiseaux-philosophes de Catherine Pineur. Avec eux, nous avions parlé de la mort et de la vie dans T'es pas mort! D'un album à l'autre, Catherine Pineur déploie ce ton si juste, à hauteur d'enfants, mêlant malice et gravité pour parler de questions éternelles. On a envie d'entrer dans la conversion des trois amis, d'y ajouter un grain de sel, de poser de nouvelles questions. En groupe ou en famille, ces albums sont de belles façons de déclencher l'échange, le partage et l'émotion.
Éclatant de couleurs, T'es où l'amour joue sur une palette chaude et pleine de vie. La texture si riche de la couleur offre aux oiseaux, dessinés d'un trait tellement épuré, un écrin parfait.
T'es où l'amour? La réponse est simple: l'amour est partout dans ce si bel album!
Pastel / L'École des Loisirs, 12.50 euros
J'emporterai le feu vient clore avec maestria la trilogie que Leïla Slimani consacre à l'histoire d'une famille marocaine. Cinq ans après La guerre, la guerre, la guerre, trois ans après Regardez-nous danser, ce troisième volet nous plonge dans les dernières décennies du 20e siècle et lance des ponts jusqu'à aujourd'hui.
Amine Belhaj, soldat de l'Armée coloniale, rencontre Mathilde en Alsace à la fin de la seconde Guerre Mondiale. Coup de foudre, mariage et installation au Maroc. L'amour qui unit le jeune couple va être mis à l'épreuve du pays des autres. Mathilde devra faire sa place au sein d'une famille, d'une langue et d'une culture dont les codes sont bien différents de ceux où elle a grandi. Amine a beau vivre dans sa ville natale, lui aussi demeure au pays des autres, il a hérité de son père un terrain qu'il rêve de transformer en domaine agricole prospère. Lui qui a donné sa jeunesse à la France, il connaît les humiliations que les Français réservent à ceux qu'on appelle "les indigènes"; il ne pourra compter que sur son travail acharné et son tempérament visionnaire pour avancer.
Aïcha et Selim sont leurs enfants. Grandis auprès de ce couple mixte, ils doivent eux aussi lutter pour se forger une vie qui ressemble à leurs aspirations. La sage Aïcha entreprend les études de médecine que sa mère n'a pas pu faire. Elle rencontre Mehdi, étudiant flamboyant, marxiste, aspirant écrivain: un jeune homme ambitieux. Le Maroc de l'après-indépendance s'ouvre à grande vitesse à la modernité: regardez-les danser! Quant à Selim, les hippies du monde entier qui affluent dans les années '70 lui offrent un horizon qu'il ne trouvait pas aurpsè des siens. Bientôt ce sera pour lui l'exil américain, la découverte de la photographie, et une nouvelle quête au pays des autres.
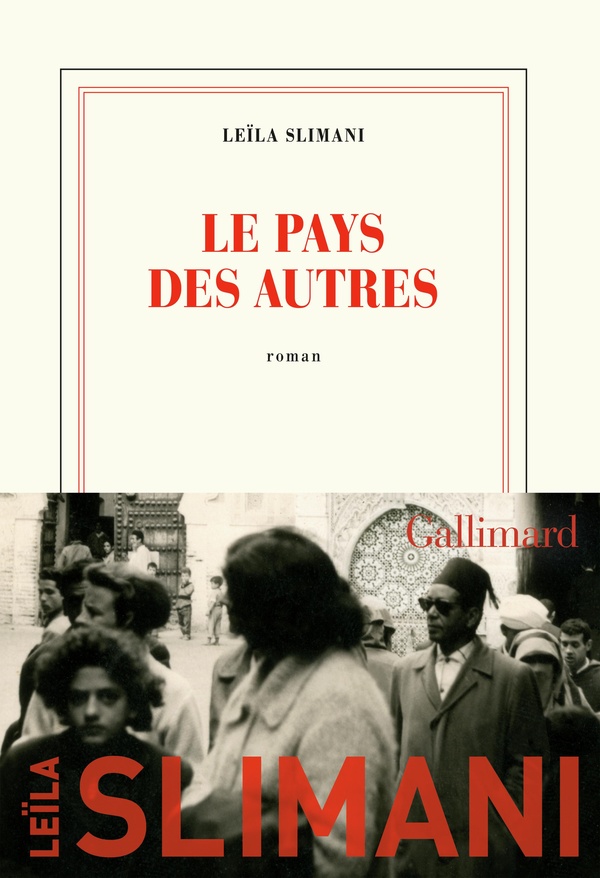 Et puis nous voici aujourd'hui à tourner avidement les pages de J'emporterai le feu. Nous retrouvons avec bonheur la famille Belhaj-Daoud et faisons la connaissance des filles d'Aïcha et Mehdi. Mia et Inès, petites filles sauvages mais confinées dans l'espace domestique, déterminées et intelligentes, sont le cœur vibrant de ce troisième volume. Des héroïnes tout aussi inoubliables que les autres personnages croisés au fil de la trilogie.
Et puis nous voici aujourd'hui à tourner avidement les pages de J'emporterai le feu. Nous retrouvons avec bonheur la famille Belhaj-Daoud et faisons la connaissance des filles d'Aïcha et Mehdi. Mia et Inès, petites filles sauvages mais confinées dans l'espace domestique, déterminées et intelligentes, sont le cœur vibrant de ce troisième volume. Des héroïnes tout aussi inoubliables que les autres personnages croisés au fil de la trilogie.
En racontant au plus près les trajectoires intimes de chacun·e, Leïla Slimani déploie sur le temps long une fresque qui frappe par son universalité et déplie des questions éminemment contemporaines. Car ce qui se joue dans les vies de Mathilde et d'Amine, d'Aîcha et Mehdi, de Mia et Inès, ce sont les rapports de domination, le poids des héritages, la place des femmes, les questions liées à l'identité. D'une génération à l'autre, chaque personnage se débat pour trouver sa place dans un territoire, un corps ou un imaginaire accaparé par d'autres.
Sensuelle, éclatante, la fresque tisse ensemble mille et un moments de vie et déploie les points de vue, les émotions, les aspirations des un·es et des autres. Chacun de ces moments a sa tonalité propre, sa couleur, son épaisseur, comme les traits d'un tableau pointilliste. Un pas de recul et l'on est subjugué par l'ampleur de la fresque, son rythme soutenu et la façon dont elle entraîne dans sa cavale tout un monde débordant de vie.
Le Maroc a trouvé avec Le pays des autres son grand roman, capable d'embrasser sa beauté et sa complexité et d'embraser les cœurs.
Disponible en format numérique ici.
Le pays des autres: la guerre, la guerre, la guerre est disponible en grand format, en poche et en format numérique.
Regardez-nous danser est disponible en grand format, en poche et en format numérique