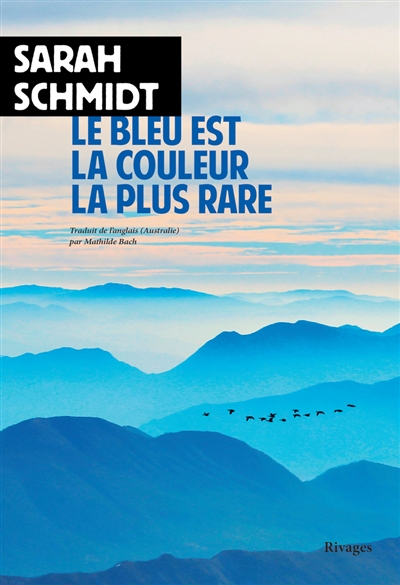Le roman oscille entre deux histoires de vies – celle d’une mère et celle de sa fille – et entre deux époques. Il démarre aux heures bleues de l’aube, dans l’est australien de 1973. Une jeune femme, accompagnée de son nourrisson, fuit la brutalité de son mari et prend la route de la chaîne des Blue Mountains, lieu des rares moments de joie de son enfance. L’angoisse est palpable, la course effrénée, mais la quiétude et la consolation semblent attendre au bout du chemin. Au fil des pages et du long voyage, l’histoire de cette femme est dépeinte par touches, et le puzzle de sa vie se construit sous nos yeux : une enfance malheureuse au sein d’une famille dysfonctionnelle, suivie d’une jeunesse sur voie de reconstruction jusqu’à la rencontre avec lui, le sanguin, le pernicieux, le toxique, et à la naissance du bébé, un soleil éclatant dans l’obscurité.
33 ans plus tôt, sa mère rencontrait un jeune soldat en partance pour la guerre qui, complètement brisé à son retour, deviendrait pourtant un jour père. De la même façon, le parcours de vie de cette femme se déploie doucement, avec subtilité, jusqu’à ce que le lecteur en découvre les stries profondes.
Le bleu est la couleur la plus rare est un roman d’une grande sensibilité, qui décrypte avec nuance la relation d’une mère et de sa fille. Sarah Schmidt, dont le talent de conteuse est indéniable, y interroge les effets du poids du silence et l’héritage des traumas à travers les générations. Elle y explore habilement les mystères tacites des liens familiaux et plus singulièrement des liens maternels. Ses personnages sont délicatement brossés, leurs ressentis paraissent plus vrais que nature et l’empathie qu’ils suscitent marquent l’esprit du lecteur.
Voici un texte empreint d’une englobante mélancolie bleue, ce qui n’empêche pas son intrigue d’intensément rebondir – rappelant ainsi au lecteur un peu rodé les tout bons romans de Laura Kasischke.
Rivages, traduit de l'anglais (Australie) par Mathilde Bach, 22 euros.