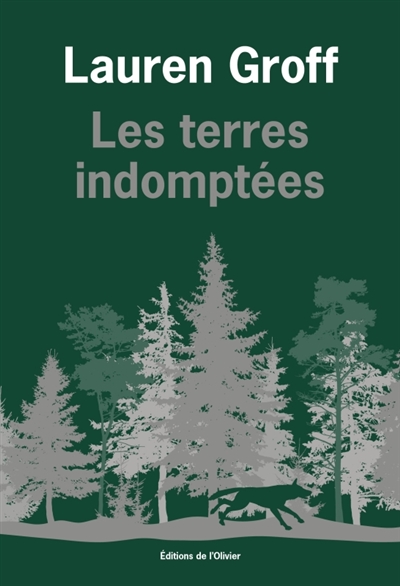C'est une fille sans nom, orpheline, domestique puis fugitive, tellement insignifiante que, si sa maîtresse veut la faire venir, elle l'appelle Zed, "car elle était toujours la dernière et la plus petite, celle qui comptait le moins, comme la plus étrange des lettres de l'alphabet".
C'est une fille sans nom et ce manque est aussi sa liberté: depuis Adam, nous savons que donner un nom, c'est proclamer sa domination sur ce qui est désigné. Être sans nom permet à la fille d'échapper aux assignations, à "la roue de la puissance".
Cette fille sans nom, si jeune et sans attaches, nous la suivons pas à pas dans une fuite haletante à travers les terres indomptées de l'Amérique du Nord. Elle a gagné le Nouveau Monde depuis l'Angleterre pour suivre ses maîtres dans leurs rêves d'évangélisation. Dans ce lointain 17e siècle, ils n'ont trouvé que famine, peste et violence.
Alors la fille s'enfuit.
Elle a sous les ongles du sang noirci, celui de l'homme qu'elle a tué avant de s'élancer. Sa rage, son endurance, sa faim de vivre auront raison des poursuivants lancés à ses trousses. La voici bientôt hors d'atteinte, dans un monde qu'elle pense vierge, "ce lieu est tel un parchemin sur lequel on n'a rien écrit, encore". Elle se trompe, bien sûr, quand elle estime que ce Nouveau Monde ne se déploie que dans l'espace et qu'elle pourra y échapper aux couches du temps qui lestent de mythes et de légendes la moindre parcelle de son pays natal. C'est là la faute première des Européens, plus grave encore que le meurtre qu'elle a commis – le péché originel de cette nation déterminée à tout dominer et aveugle à ce qui lui est étranger.
La fille trace son chemin, déterminée, persévérante. Avec elle nous affrontons le froid, la faim, la peur, l'humidité, la fièvre, les animaux sauvages et les hommes, tellement plus dangereux qu'ours et loups. La fille seule dans les bois est un motif littéraire universel: tant de contes, de récits mythiques, de romans l'ont mise en scène. Lauren Groff le fait à sa façon singulière, résolument contemporaine. Son roman est un conte cruel de jadis qui aurait intégré les questions de l'anthropocène et l'héritage féministe.
Quand, au terme du voyage, la fille aura trouvé un lieu où s'ancrer, l'aventure se poursuivra sur un mode nouveau, plus métaphysique. Après les embûches du chemin, c'est le poids des souvenirs et l'abyssale solitude que la fille devra affronter: "survivre seule, ce n'est pas la même chose qu'être vivante". Les voix qu'elle porte en elle sans parfois les comprendre l'accompagnent dans son cheminement. Et la beauté de la nature, l'émerveillement né de sa contemplation, les scintillements du ciel et "les chants des oiseaux comme une émeute dans l'air", tout l'invite à prendre part à l'harmonie du monde. Renaît alors en elle "une vibration profonde dont elle ne savait pas qu'elle s'était désaccordée". La langue fine de Lauren Groff, qui ne craint pas le lyrisme et les accents visionnaires, fait merveille pour capter la grâce et glorifier cette beauté du monde. Elle l'exprime en scènes d'une grande puissance, tel ce moment suspendu où un ours fasciné et concentré contemple les reflets de la lune dans les eaux d'une cascade.
Les terres indomptées capture l'essence des grands romans américains – la violence et la quête de rédemption, les frontières à reculer, l'aventure et l'effroi – pour la redéployer sous un prisme féministe.
Avec ses références bibliques, sa langue incantatoire, son obsession de la survie, Les terres indomptées ne manque pas de faire penser à certains romans de Cormac McCarthy. C'est dire si Lauren Groff a fait sa place parmi les très grands.
Éditions de l'Olivier, traduit de l'anglais (États-Unis) par Carine Chichereau, 23.50 euros