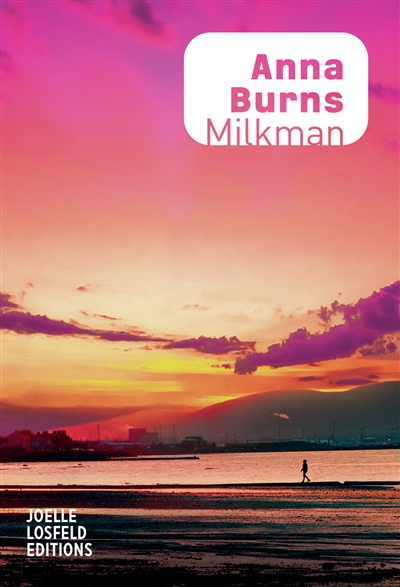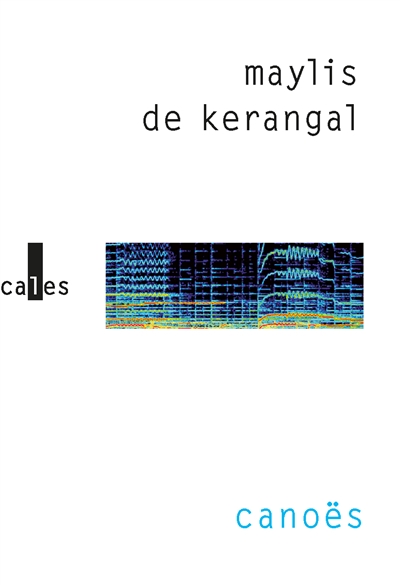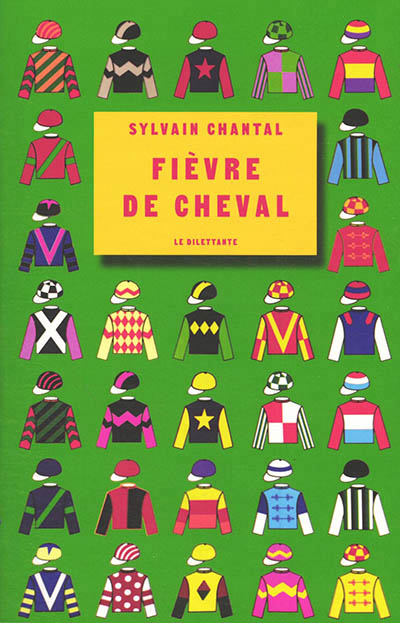Nos lectures
L'avis de Maryse:
de Maryse:
À nouveau, voici un roman belge, publié chez Gallimard, qui vaut le détour !
2005 à Ravina, un bourg isolé de Basilicate, la région du sud de l’Italie « dont on dit, tant sont peu nombreux ceux qui la connaissent, qu’elle est un peu comme Dieu lui-même, réelle et imaginaire, ne se laissant ni facilement décrire ni atteindre par le temps. » Alors que le village est en fête, la jeune Chiara, fille des propriétaires de l’épicerie et nièce de l’agriculteur Pasquale Serrai, disparait. Des jours durant, malgré les battues des carabinieri et la mobilisation de tout le village, elle reste introuvable. Très vite, les chaînes de télévision et les rédacteurs de gazettes locales et nationales vont s’implanter dans les lieux jusqu’alors ignorés, et s’emparer de l’affaire, la transformant en un macabre et voyeuriste roman-feuilleton suivi par le pays entier et dont plusieurs villageois deviennent les personnages-vedettes. Au cœur de l’angoisse, de l’indignation et de la tristesse se révèlent frustrations, jalousies, et haines enfouies.
C’est Sandro, orphelin pris sous l’aile de Serrai et jeune homme mis au ban de ce petit monde à l’époque des faits, qui, des années plus tard, raconte le funeste épisode qui avait bouleversé la vie d’ordinaire si taciturne d’une région où tout le monde croit connaître tout le monde...
Le roman de Giuseppe Santoliquido prend vite la forme d’un bon thriller haletant et pourtant, c’est la fine analyse de ce que peut revêtir une société rurale, géographiquement isolée, aux hommes et aux femmes que le dur labeur a maintenus butés, inflexibles, envieux et intransigeants qui est à retenir. C’est aussi une réflexion sur la façon dont les médias – et ce même avant l’arrivée massive de Facebook et autres réseaux sociaux – récupèrent une atroce réalité afin de la servir chaude et bien croustillante à des spectateurs en mal de sensations. Mais surtout, c’est une écriture juste, accomplie et véritablement élégante qui transporte le lecteur de la première à la dernière ligne de ce très bon roman.
Disponible en format numérique ici
Voici un roman bref, sobre et fort, au style si particulier et à la sensibilité tellement profonde que le moment fugace de sa lecture résonne encore et encore.
Nous sommes en pleine campagne flamande, dans une vaste et calme demeure bordée d’un immense jardin et d’un étang. Aux portes de l’adolescence, une jeune fille vit chez ses grands-parents depuis ses deux ans. « Enfant naturelle », elle a été laissée là par sa mère, qui ne revient pas. La grand-mère est aimante, quoique silencieuse, pudique et distante. Le grand-père, figure drue et autoritaire, quant à lui, se meurt à petit feu au fond de son lit. Cet été-là, les journées de l’enfant solitaire s’écoulent doucement dans le grand jardin, son corps immergé dans l’étang, ses mains enfouies dans la terre du potager, le fond de ses narines inondé de l’odeur de la vase et son esprit navigant sur les flots des premiers émois, des petits bonheurs, des grands tourments et de l’infinité qu’offre l’imagination propre à cet âge de la vie. Puis, les jours sont aussi ponctués par l’intimidante visite au patriarche mourant.
L’eau, la vie, la mort… Autant de thématiques omniprésentes dans cet instantané singulier où la nature est souveraine. Entre le rêve et la réalité, le lecteur tangue. L’écriture est magnétisante, les ressentis intenses, alors même que somme toute, le quotidien se déroule dans une routine taciturne. En fait, à l’instar de la fille, l’eau de l’étang semble calme mais pourtant renferme en elle une puissante force de vie et de mort.
Avec Debout dans l'eau, l'écrivaine belge, primo-romancière, Zoé Derleyn fait entendre une voix littéraire extrêmement singulière à découvrir, vraiment, et à suivre, sans aucun doute.
Disponible en format numérique ici
Ce livre est une bombe, et l'énergie qu'elle dégage en se fragmentant vous irradie pour longtemps.
Au centre de Milkman, une fille de 18 ans. Elle n'a pas de nom, appelons-la "Sœur du milieu" puisque c'est ainsi qu'on la désigne dans la famille. "Sœur du milieu" est la quatrième de sept filles – sans oublier trois frères –, dont les aînées sont nommées par leur ordre dans la fratrie et les cadettes, pas sorties de l'enfance, forment le réjouissant chœur des "Chtites", espiègles et perspicaces.
Pour son "peut-être petit ami", elle est "peut-être petite amie". Cette relation marquée du sceau de la "peut-êtritude", cette relation "ni vraiment oui, ni vraiment non", la narratrice la dissimule avec beaucoup de soin. À sa mère, bien sûr, qui s'inquiète qu'à 18 ans sa fille ne soit pas encore mariée et mère. À la communauté, qui n'aime rien tant que saccager les histoires d'amour, au point que souvent les gens préfèrent épouser la mauvaise personne pour éviter de se voir arracher leur amour vrai.
"Sœur du milieu" est encore, aux yeux des habitants de la petite ville, "Celle qui lit-en-marchant". C'est une des façons qu'elle a de tenir à distance un réel envahissant. Mais lire-en-marchant la classe dans la catégorie des dépassants-les-bornes, d'autant qu'elle ne lit que des romans anciens pour échapper à ce siècle où elle n'a pas sa place. Dans une société fermée, gangrenée par la méfiance et les préjugés, le commérage et la rumeur tiennent lieu d'unique défouloir et il ne fait jamais bon se démarquer.
Ce monde où l'on avance en biais, en se dissimulant, en ne sachant jamais si l'on agit par bon sens ou par paranoïa, c'est l'Irlande du Nord des années '70, mais cela pourrait être tout autre terre prise dans l'étau du colonialisme, du communautarisme, des identités assignées. Anna Burns décrit son pays natal avec une précision folle, et en même temps suffisamment de recul pour que son roman prenne une résonance très universelle.
Le conflit entre les "renonçants" et "ceux de l'autre côté" (de la rue, de la mer) déclenche une haine si puissante qu'il anéantit toute intimité, toute intériorité. Les gens sont "encercueillés et enterrés" de leur vivant, insensibles à la nuance, inadaptés pour le bonheur et la beauté. Et le conflit géopolitique rend acceptable, voire désirable, la domination de ceux qui prennent les armes pour leur peuple, et qui cachent trop souvent sous la noblesse de leur cause des pratiques de gangsters: prédation, violences faites aux femmes, surveillance, censure. Autant de travers que concentre Milkman, l'effrayant chef de guerre aussi craint que respecté, qui poursuit "Sœur du milieu" de ses assiduités et qui, s'il n'apparaît qu'une poignée de fois dans le roman, le plonge tout entier dans son ombre de dangereux harceleur.
De bout en bout, le chemin de "Sœur du milieu" est un apprentissage de la liberté. Liberté de refuser l'emprise de Milkman. Liberté de penser, d'aimer, d'éprouver. Liberté de chercher "une autre façon de vivre": "c'était, sous les traumatismes, sous l'obscurité, une normalité qui essayait d'advenir".
Cette quête obstinée, inflexible, menée par une toute jeune fille à qui personne n'a transmis de mots à mettre sur ses émotions ni appris que le harcèlement et la sujétion ne sont pas une fatalité, donne au livre une dimension absolument poignante – parfois cocasse, le plus souvent déchirante.
Mais ce qui fait de Milkman un livre vraiment hors du commun, c'est son rapport à la langue. Quand les idéologies partisanes vident les mots de leur sens, il faut déserter cette langue officielle et en forger une neuve. "Sœur du milieu" ne perd jamais de vue qu'il lui faut désamorcer la fausse langue et ses éclats mortifères. Le résultat est fascinant: une langue inventive, audacieuse, fourmillant de singularités et de trouvailles. On ne peut que rendre grâce à la traduction feu d'artifice de Jakuta Alikavazovic. Il fallait une autrice de son talent et de sa sensibilité pour rendre toute sa puissance de déflagration à la langue d'Anna Burns.
Éditions Joëlle Losfeld, traduit de l'anglais (Irlande du Nord) par Jakuta Alikavazovic, 22 euros
Disponible en format numérique ici
Canoës ramasse en une épure tout ce qui se joue dans le travail romanesque de Maylis de Kerangal. En huit textes qui fonctionnent entre eux comme un ensemble organique, pulsant une même énergie, on trouve déployées les questions au centre d'une œuvre qui compte d'évidence parmi les plus captivantes d'aujourd'hui. Canoës compose un paysage de corps et de voix qui s'aimantent, s'additionnent, se diffractent, se reflètent. La circulation est fluide entre tous ces textes tissés serrés par des jeux d'échos et des mises en réseau (telle date qui revient, l'ombre d'un oiseau, un enfant aux yeux sombres, la quête d'une fréquence audible dans les stridences de la radio). Maylis de Kerangal est décidément une architecte aussi virtuose dans la forme brève que dans ses romans-épopées.
Poursuivant le chemin pris avec Un monde à portée de main, Canoës explore l'intime et prend le risque de la première personne. Les textes mettent en scène des femmes dans un moment de fragilité. Toutes sont, volontairement ou pas, déroutées de leur vie ordinaire («aux aguets, vulnérable, précaire», «désajustée», «légèrement décollée de moi-même»). On attend d'elles qu'elles s'adaptent et trouvent un nouveau point d'équilibre, mais elles jouent la résistance. Ainsi dans «Mustang», la novella centrale, une jeune Française installée au Colorado n'arrive pas à se couler dans son nouvel environnement: «je résistais, cabrée, réfractaire», et pourtant «anxieuse à l'idée que les espèces qui ne s'adaptent pas disparaissent inéluctablement». Les cheminements intimes de ces femmes d'âges et d'horizons différents sont saisis au plus près de leurs tâtonnements par une écriture vive, précise, cueillant la moindre inflexion du corps et de la pensée.
Mais ce sont surtout les voix que Canoës s'efforce d'attraper. Leur timbre, leur souplesse, leur singularité, ce qui transforme le souffle humain en «matières acoustiques», en «ruisseau de montagne», en paysage intime. Rien n'échappe à l'acuité de Maylis de Kerangal: voix enregistrées, captées par une radio, un répondeur, un micro, ou voix qui murmurent au creux de l'oreille; voix qui trébuchent, bégaient, se cherchent; voix du souvenir aussi, celles des morts aimés que l'on cherche à retrouver. Cette patiente quête des voix donne à chacun des personnages croisés dans Canoës un degré d'incarnation et de présence d'une rare puissance. Car s'il n'y a rien de plus fragile et de plus évanescent qu'une voix, il n'y a pas non plus meilleur sismographe de la vérité d'un être. La voix s'accorde dans une zone qu'aucune posture, qu'aucune bravade ne peut faire mentir.
Les canoës du titre glissent avec fluidité sur le lit creusé par toutes ces voix. De texte en texte, le motif du canoë offre sa polysémie gracieuse. Si le mot renvoie au mouvement, à la légéreté, à la vitesse, il ramasse aussi l'idée de disparition et d'impossible deuil pour les peuples indiens massacrés. Deux nouvelles sont arrimées dans les paysages des Grandes Plaines américaines, mais tous les autres textes ont à voir avec la perte, la quête des traces, le travail de mémoire.
Le canoë est peut-être aussi, par sa capacité à apporter biens et messages d'une communauté à une autre, comme une image de l'écriture elle-même cherchant à ramasser et transmettre des éclats de réel. Dans le sillage d'Ursula Le Guin, le livre donne corps à l'idée d'une fiction comme contenant, réceptacle. Et ce n'est sans doute pas un hasard si les femmes croisées dans Canoës ont des poches, des paniers, des sacs qu'elles remplissent «de vestiges, de reliefs, de petites choses». La nouvelle «Mustang» se termine avec l'évocation d'un bol tourné par la narratrice: «me portait le rêve de fabriquer un jour un bol, un simple bol, où je pourrais garder ce que j'ai glané dans ce pays, et le rapporter chez moi». Le canoë serait le lieu pour ressaisir «ce qui se tient disjoint».
Et l'on se sent gagné, dans chacun de ces huit textes, par «la crue de l'émotion», une émotion qui irrigue tous les sens et démultiplie les perceptions. La somptueuse beauté de la langue de Maylis de Kerangal, son sens narratif, sa générosité : tout fait empreinte dans nos vies de lecteurs, tout élargit notre espace de rêve et de pensée.
Disponible en format numérique ici
Un monologue cocasse, celui d’Anatole, un ancien consultant (en quoi, déjà ?), que la solitude et l’ennui ont projeté dans le bar PMU de son quartier. Un peu malgré lui, graduellement, il s’est laissé envahir par la fièvre des paris. Turfiste devenu stratège, il dépeint avec allant le monde des fameux bistrots français de paris équestres, ses piliers de comptoir, ses miseurs obstinés, ses tenanciers désabusés, ses Omar Charif en perdition…
Tiercé, quarté, quinté plus : faites vos jeux !
Le portrait par lui-même d’un gentil loser emberlificoté sans l’avoir senti venir dans des rencontres rocambolesques et des trafics douteux. Le style est enlevé, caustique, je dirais même galopant ; la description véritablement pittoresque.
Fièvre de cheval de Sylvain Chantal : voici la lecture décalée de ce printemps tardif !